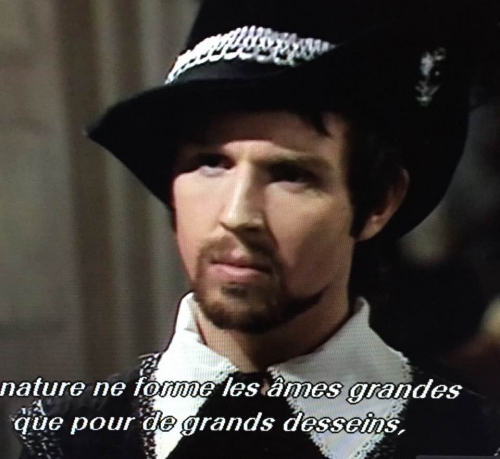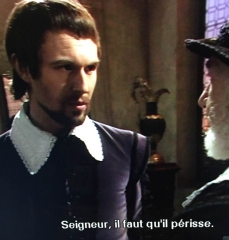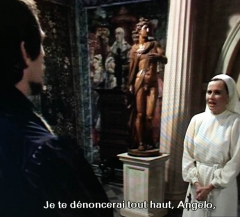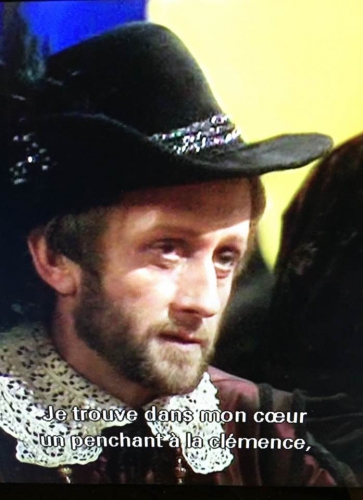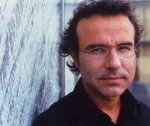

Sur L'enfant d'octobre de Philippe Besson. 12 ans après...
Un débat assez inepte se développe ces jours, dans les médias, à propos du droit d’un romancier à se servir d’un fait divers pour en tirer une fiction. Le prétexte en est le dernier roman de Philippe Besson, L’enfant d’octobre, qui réinvestit à sa façon la mémorable affaire Villemin.
Je n’ai pas encore lu ce roman et ne saurais donc en juger quoique, me rappelant les livres précédents de l’auteur, et considérant la minceur de celui-ci, je doute un peu qu’il fasse vraiment le poids. Ce qui est sûr, en attendant, et c’est pourquoi le débat lancé me semble inepte, c’est qu’on est très mal parti en discutant le droit d’un romancier à s’inspirer d’un fait divers « réel », le seul et unique problème étant évidemment ce qu’il en fait.
Bien entendu, le roman ne saurait être réduit à l’ universel reportage que stigmatisait Mallarmé, mais exclure la substance « reportage » du roman en général équivaut à se priver de milliers de pages intéressantes, dont je ne citerai à la volée que le « reportage » traitant de la genèse et du développement du journalisme moderne dans Les illusions perdues de Balzac, ou cet autre « reportage » signé Philip Roth, dans Pastorale américaine, consacré à la fabrication des gants de peau dans une petite entreprise familiale de Newark, vers les années 50.
Le rôle de la littérature se borne-t-il à nous renseigner sur la fabrication des gants de peau dans le New Jersey ? Peut-être pas. Mais je n’aimerais pas non plus que le roman ne fût qu’une combinatoire narrative ou qu’une fantasmagorie de lettreux claquemuré. On se gardera de demander au professeur Mallarmé, sujet aux rhumes et aux rhumatismes, d’écrire Crime et châtiment ou Le bruit et la fureur, « basés » tous deux sur des faits divers et que le professeur Nabokov conchie pour cela même avec la même impériale mauvaise foi , pas plus qu’on ne demandera à James Ellroy, qui a tiré du fait divers du meurtre de sa mère ce formidable roman-repotrage que représente Ma part d’ombre, tel poème cristallin de Mallarmé ou tel génial roman « non réaliste», ou prétendu tel, de Nabokov. Mais pourquoi donc se priverait-on des uns ou des autres, comme si l’éléphant de la ménagerie excluait le calao ou la belette ?
Quant à la question « éthique » se rapportant à l’usage que font les romanciers du « réel », elle relève essentiellement, en l’occurrence, d’une morale à la petite semaine démagogique, assez typique de la logique médiatique, à l’enseigne de laquelle le fait divers n’est le plus souvent traité que dans son vampirique sinon putanesque usage quotidien, qui exclut a priori toute réflexion et toute interprétation incarnée (le propre du vrai romancier) et par conséquent toute position éthique…
Post Scriptum
Emotion et justesse: ainsi Thierry caractérisait-il, dans les commentaires de ce blog, L'enfant d'octobre de Philippe Besson, que je viens de lire à mon tour avec le même sentiment final dissipant mon scepticisme. La version de l'écrivain est-elle la bonne ? Nul n'en sait rien, mais son portrait d'un couple farouche, et farouchement lié bien au-delà de la mort de Grégory, est tout à fait plausible. A fines touches précises, évitant tout sensationnalisme, visiblement bien documenté, Philippe Besson reconstitue ce drame en eaux glauques par un jeu de contrepoint faisant alterner le récit des faits et la voix de Christine Villemin. Celle-ci a dit ne pas se reconnaître dans cette voix, et sans doute est-ce la partie la plus délicate du livre, dans la mesure où le personnage, tel qu'il apparaît du dehors, ne correspond pas tout à fait à ce monologue très sensible et un peu trop littéraire peut-être ? Mais on peut le prendre, aussi, comme une voix tout intérieure, et pourquoi ne pas prêter cette lucidité douloureuse à cette femme soumise à toutes les épreuves ? Ce qui est sûr, c'est que Philippe Besson rend très bien l'épouvantable gâchis de cette sombre affaire, que les médias ont contribué à embrouiller plus encore. Le romancier en tire une sorte d'épure pleine d'empathie à l'égard du couple Villemin, sans l'angéliser pour autant. Le cadre social sinistré, la jalousie, la haine suscitée par les deux jeunes gens, puis l'emballement judiciaire et médiatique: tout cela est rendu avec clarté. On n'est ni chez Bernanos ni chez Dostoïevsvki, mais les médias sont mal venus de remettre en cause le principe même de ce livre, à mes yeux fondé sur une démarche légitime. Fallait-il changer les noms des protagonistes, comme lorsque Jules Romains fait de Landru un Quinette ? Le débat paraît vain s'agissant d'une telle affaire, interprétée sans la mauvaise curiosité et le vampirique goût du sang qui en a marqué les développements médiatiques. Le même problème se posait à Emmanuel Carrère quand il s'est intéressé au mythomane criminel Jean-Claude Romand pour en tirer L'adversaire, et la même solution semblait également défendable. Enfin, Philippe Besson me semble beaucoup plus juste, en l'occurrence, par son empathie et sa réserve, qu'une Marguerite Duras en son obscène numéro du Forcément sublime...
Philippe Besson. L'enfant d'octobre. Grasset, 2006.