
Partagées par une dualité fondamentale, la vie et l’œuvre du grand écrivain trouvent leur unité dans le miracle d’une écriture fondée en humanité et visant un idéal fraternel. Anne Marie Jaton, dite la Professorella, après ses remarquables approches de Cendrars, Bouvier, Cingria, Chessex ou Queneau, éclaire les deux faces d’une œuvre de folle verve et de noire lucidité.
Chronique de JLK
C’est d’abord l’histoire, à valeur de scène primitive, d’un garçon de 10 ans sortant à peine des verts paradis où il fut l’enfant-dieu de sa mère, pour se trouver soudain confronté à l’abjection de notre drôle d’espèce.
Cela se passe en 1905 dans une rue de Marseille où la famille Coen s’est réfugiée à la suite de graves persécutions antisémites en l’île de Corfou, et voici qu’un camelot, vantant dans la rue les vertus d’un détachant «universel», s’en prend soudain au gosse à teint bistre et boucles noires du premier rang en lequel il identifie un «youpin», qu’il houspille avant de lui conseiller d’aller voir à Jérusalem s’il y est…
Comme nul ne prend, alors, la défense de l’enfant insulté, celui-ci vit l’agression comme une révélation de sa «différence» et d’un motif possible de rejet et d’exclusion. Un an plus tard, le Juif Dreyfus sera innocenté, au soulagement du père Coen, mais l’antisémitisme fera désormais partie de la vie d’Albert, ajoutant plus tard un h à son nom, même s’il n’est pas lui-même un Juif pratiquant, véritable macédoine identitaire à lui seul puisqu’il est Gréco-Turc par son père et Vénitien par sa mère, Genevois d’adoption à l’âge d’amorcer des études de droit, et ensuite Français de culture, Occidental aimant et détestant l’Occident (où Goethe et Mozart n’excluent pas Hitler) comme il aime et déteste sa filiation juive, jamais réconcilié avec un Dieu qui a «vu» l’anéantissement du ghetto de Corfou et les camps de la mort sans lever le petit doigt.
Dès ses premiers poèmes (répudiés par la suite), Albert Cohen a d’ailleurs marqué sa distance par rapport au Dieu biblique. Cependant, toute sa vie durant, une espèce d’inquiétude «pascalienne» le hantera, liée à la place de l’homme sur cette terre, cerné de mystère dès sa naissance et conscient, voire obsédé (c’est son cas) par l’idée de la mort, parfois même tenté par le suicide.
 Ma sœur, passeur (e), la Professorella…
Ma sœur, passeur (e), la Professorella…
Le féminin de passeur est, en langue inclusive, passeure, mais je lui préfère quant à moi, s’agissant d’Anne Marie Jaton, le surnom de Professorella, au motif que celle-ci, issue de milieu lausannois plutôt modeste, devenue titulaire de la chaire de littérature française à la prestigieuse faculté des lettres de Pise, incarne elle aussi, à mes yeux, le miraculeux mariage des contraires par sa façon de conjuguer l’érudition joyeuse et l’intelligence du cœur, avec une vraie passion de transmettre
Or me demandant ce qui l’a intéressée chez Albert Cohen après ses livres consacrés à Cendrars et à Nicolas Bouvier, à Jacques Chessex et à Raymond Queneau, je me dis là encore: le mariage des contraires. De Cendrars, en effet, elle a montré la double nature épique et mélancolique; de Nicolas Bouvier, le mélange de curiosité universelle et de repli inquiet; de Chessex, la sensualité revendiquée et l’ombre puritaine; de Raymond Queneau, l’apparente fantaisie et la gravité secrète.
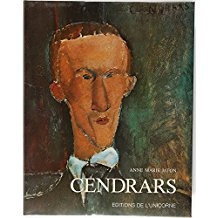
Autant dire qu’il n’est pas si étonnant que cette universitaire atypique couverte de chats et de chiens, épouse d’un vieux sage du barreau italien qui ne fut pas pour rien dans la fondation des auberges de jeunesse de la réconciliation européenne, fasse ami-ami avec le fringant Solal, l’adorable Ariane de Belle du seigneur, les Valeureux de Céphalonie et toute la smala des personnages de Cohen.
Anne Marie Jaton est, en outre, une lectrice infiniment poreuse, capable d’autant d’attention à l’égard du dernier épisode de la série du commissaire sicilien Montalban qu’à la réflexion proposée par René Girard sur le mimétisme amoureux. C’est ce qui fait de sa lecture d’Albert Cohen une possible (re)découverte vivifiante.
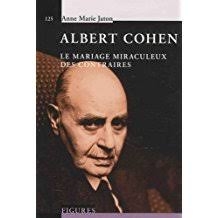 Entre l’alcôve, le bureau et les camps.
Entre l’alcôve, le bureau et les camps.
Lorsque son fils Albert étudiait le droit à Genève, non sans courtiser diverses dames avant d’en trouver une dans la bonne société calviniste, sa mère adorante, à Marseille, continuait de placer son couvert sur la table, en réservant les meilleurs morceaux à l’Absent au jour de son anniversaire. On peut ricaner, mais ce serait ne pas voir la grandeur quasi mythique de cette relation dont le père (ce gorille) est exclu, et qui prépare une singulière révision de ce qu’on appelle la passion amoureuse, telle que l’a décrite Denis de Rougeneont dans son fameux Amour et l’Occident.
La Professorella, à qui on ne la fait pas – on n’enseigne pas les subtilités de l’amour en littérature aux jeunes étudiants italiens férus de séries télévisées sans en tirer quelque expérience -, souligne justement l’importance de l’extravagante introduction de Belle du seigneur, fantastique illustration de la passion mimétique, avant de relever aussi le génie satirique d’Albert Cohen, dans son évocation des bureaux kafkaïens des institutions internationales où pontifie Adrien Deume - cela pour la tétralogie incluant Solal, Belle du seigneur, Mangeclous et Les Valeureux, qui ne devraient faire qu’un.
Solal le magnifique, dont le nom suggère la double nature solaire et solitaire, se déguise en vieillard hideux dans l’ouverture de Belle du Seigneur afin de séduire la belle Ariane qui lui a tapé dans l’œil lors d’une soirée. La mascarade introduit illico un thème récurrent de toute l’œuvre romanesque de Cohen, sur fond de comédie sociale tissée de mensonges : celui de notre réalité mortelle que nous ne cessons d’éluder. Ensuite le séducteur pourra revenir à la charge à visage découvert, mais c’est sa propre image, et celle de l’amour idéalisé, qui se fracassera après les feux de la passion, reflétant la vision pessimiste, voire parfois désespérée, de l’écrivain qui, là encore, produit un flamboyant chant d’amour au revers désenchanté.
Et puis il y a la mort semée par les hommes, à l’horizon de l’histoire avec une grande Hache. Dans la partie de l’œuvre qu’Anne Marie Jaton appelle «les œuvres du moi», et plus précisément dans Ô vous frères humains, Albert Cohen a parlé des camps de concentration, comme le narrateur des Valeureux
exprime son horreur au moment du départ de ses cousins pour Marseille : « Soudain me hantent les horreurs allemandes, les millions d’immolés par la nation méchante, ceux de ma famille à Auschwitz et leurs peurs, mon oncle et son fils arrêté à Nice, gazés à Auschwitz ».
Et dans ses Carnets de 1978, trois ans avant sa mort, c’est à Dieu lui-même que l’écrivain s’adresse en revenant sur l’incompréhensible horreur : «Tu as accepté tant de malheurs sur le peuple de Ton choix. Auschwitz, Dachau, Treblinka. Tant de malheurs injustes et tant de bonheurs immérités. Seigneur Dieu, explique Ton silence, justifie Ton indifférence».
Et la Professorella de conclure : «C’est sur cet appel, sur l’évocation de cette obscure énigme, l’une des plus angoissantes du 20 et du 21e siècles et sur laquelle se sont interrogés théologiens et philosophes – en particulier Jans Jonas dans Le concept de Dieu après Auschwitz – que se termine l’œuvre du moi».
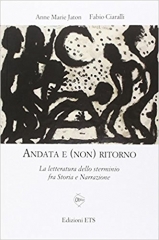 Sur le même thème, Anne Marie Jaton a publié, en 2015, avec Fabio Ciaralli, un passionnant aperçu de la littérature suscitée par l’extermination, où les témoins directs, de Primo Levi à Imre Kertsez ou Elie Wiesel, Etty Hillesum ou Charlotte Delbo, ont osé exprimer, avec leur âme et leurs tripes, mais aussi leur talent, en écrivains ou en poètes, ce qu’on croyait indicible.
Sur le même thème, Anne Marie Jaton a publié, en 2015, avec Fabio Ciaralli, un passionnant aperçu de la littérature suscitée par l’extermination, où les témoins directs, de Primo Levi à Imre Kertsez ou Elie Wiesel, Etty Hillesum ou Charlotte Delbo, ont osé exprimer, avec leur âme et leurs tripes, mais aussi leur talent, en écrivains ou en poètes, ce qu’on croyait indicible.
Terrible traversée que celle de ce livre (non encore traduit en français), qui s’achève sur un poème de Charlotte Delbo faisant écho à l’appel de Cohen à ses frères humains en nous interpellant d’un déchirant Ô vous qui savez : «Vous saviez que les pierres des routes ne pleurent pas / Qu’il n’y a qu’un seul mot pour l’épouvante / Un seul mot pour l’angoisse ? Vous saviez que la souffrance n’a pas de limite / L’horreur aucune frontière ? / Vous le saviez, vous qui savez ? »
La fraternité au bout de la nuit
Mais on verra que les Valeureux incarnent aussi cette forme d’amour «malgré tout» que représente l’humour, sur la face lumineuse de l’œuvre, et que toutes les contradictions liées à la condition humaine, la dualité des individus, la méchanceté née de la peur ou du besoin de dominer, les fractures culturelles ou les dissensions idéologiques peuvent être dépassées.
Il ne s’agit pas de dorer la pilule mais d’aspirer, selon l’expression de Cohen lui-même, au «mariage miraculeux des contraires». Le macho Solal reste à certains égards un enfant, les personnages les plus vivement épinglés par le satiriste, tel le pauvre Adrien Deume, ont droit finalement à la même tendresse que le père de l’écrivain, longtemps perçu comme un rival écrabouilleur.
Parfois déconcertante par son baroquisme échevelé à l’orientale, les monologues pléthoriques d’Ariane ou ses dissonances musicales à la Mahler, l’œuvre d’Albert Cohen, dont le langage est à la fois de sel et de miel, selon l’expression de la Professorella, est finalement concertante en cela qu’elle exprime «en musique» qu’un accord avec le monde, et même avec notre terrible espèce, ne relève pas que du pipeau…
Anne Marie Jaton. Albert Cohen, le mariage miraculeux des contraires. Presses polytechniques et universitaires romandes, collection Le Savoir suisse, 121p.
Anne Marie Jaton et Fabio Ciaralli. Andata e (non) ritorno, la letteratura dello sterminio fra storia e narrazione. Edizioni ETS, 2015.
Commentaires
J’ai lu avec intérêt et plaisir votre article, vous avez maintes fois cité « la Professorella » à différentes occasions et c’est avec engouement que je lirai les livres en référence.