
Entretien avec Catherine Safonoff
L'écrivain genevois recevra cette semaine le Prix Dentan 2007. Et le Grand Prix de Littérature de la Ville de Genève, en mai prochain.
Certains livres semblent marqués au sceau d’une vérité personnelle profonde, que la transmutation de l’écriture rend valable pour tous. Et tels sont, précisément, les deux derniers récits-romans de Catherine Safonoff. Au nord du Capitaine, paru en 2002, évoquait la folle passion de la narratrice, double transparent de l’auteur, pour une espèce de Zorba crétois aussi sauvage et authentique que dangereusement voyou, lequel réapparaît dans Autour de ma mère, journal-roman oscillant entre les tribulations d’une mère nonagénaire irascible et perdue, et les derniers feux d’un impossible amour. Dès La part d’Esmé, son premier roman, Catherine Safonoff était entrée en écriture par les voies de l’exorcisme, sublimé par une écriture de grande qualité. Un manque d’amour initial, les aléas du couple, la difficulté de vivre, mais aussi les cadeaux de la vie, les enfants, les livres, les amitiés, se trouvent rebrassés dans la chronique proustienne et merveilleusement poreuse d’Autour de ma mère.
- Quelle sorte d’enfant avez-vous été ?
- Je suis fille unique. Jusqu’à cinq ans, notre famille vivait groupée dans une maison du quartier des Charmilles, où cohabitaient plusieurs générations, avec beaucoup d’enfants, car ma grand-mère accueillait encore des petits Français bousculés par la guerre. Nous vivions là dans une sorte de matriarcat, mené toute en douceur par Marie de Safonoff, la mère de mon père, qui avait épousé un Russe blanc exilé avant la Révolution, lequel disparut bientôt pour claquer sa fortune sur la côte française. Ce fut une bonne époque de mon enfance. Quand j’ai commencé l’école, je me suis retrouvée seule avec mon père et ma mère, et ce fut une autre chanson. Mes parents ne s’entendaient pas. Il y avait peu d’argent. Mon père était électricien aux postes. Ma mère avait repris une vocation institutrice. Pour moi, ce qui comptait était de sortir, pour échapper à leurs disputes.
- La lecture et l’écriture vous ont-t-elles aidée ?
- Certainement, malgré le fait qu’à part les livres de montagne de mon père, qui n’était heureux que dans la nature, et les ouvrages scolaires de ma mère institutrice, il n’y avait pas de livres à la maison. Un premier choc, que je dois à une camarade qui rangeait la bibliothèque de sa mère, a été la découverte de Colette, dont j’ai ensuite tout lu. Un vrai cadeau : plus encore que les sujets, c’est la magnificence de sa langue qui m’a enchantée. Par ailleurs, j’ai été sensibilisé à la bonne langue par ma mère. Plus tard, une autre révélation, sur le conseil de Georges Ottino, un professeur que j’aimais, fut celle de Pascal. Ensuite, lorsque j’ai commencé des études de lettres, j’ai pensé consacrer un travail aux romans de Robbe-Grillet. Mais l’écriture, ce fut bien plus tard. D’abord par compensation à des études de lettres où j’avais une peine énorme, et trop peu de moyens financiers. Ensuite par exorcisme existentiel. Mon premier roman, influencé par le Nouveau Roman, illisible et probablement nul, je l’ai écrit aux Etats-Unis, où je me trouvais avec mon second mari, boursier en recherche médicale, pour me prouver que j’en étais capable. Mais mon premier vrai livre, La part d’Esmé, est né d’une nécessité plus profonde : à vrai dire vitale, liée à l’état de malheur dans lequel j’ai vécu après la séparation d’avec le père de mes enfants.
- Comment Autour de ma mère a-t-il pris forme ?
- Lorsque ma mère a commencé à décliner, je me suis sentie si débordée, si désemparée par ce qui lui arrivait, avec cette dégradation physique et ce délire qui la prenaient alors qu’elle avait été la raison pure, tout cela, avec ces longs téléphones terribles, a fait que je me suis mise à tenir un journal pour tâcher d’y voir plus clair. D’un autre côté, l’espoir déçu de renouer avec celui que j’appelle le Capitaine accentuait le déséquilibre. Ecrire m’aidait peut-être à rétablir l’équilibre…
- Ecrire vous est-il aisé ?
- Très difficile. La grande difficulté consistant à passer de l’observation et de la perception des choses, à leur mise en mots et en forme.
- Quelle place les enfants ont-ils dans votre vie ?
- Sans parler du fait que je m’entends bien, aujourd’hui encore, avec mes deux filles, enfanter et vivre avec des enfants a été l’une des grandes expériences de ma vie, avec l’amour. En fait, je crois qu’on pourrait distinguer deux sortes d’écrivains : ceux pour qui les enfants comptent, et les autres…
- Qu’avez-vous à cœur de transmettre ?
- Peut-être ceci : qu’entre le monde et nous on peut établir un lien de parole, à la fois joyeux, sensible, triste s’il le faut, mais vivant. Que la parole entre deux êtres compte. Qu’il est important de se parler et de s’écouter les uns les autres. J’aime, pour ma part, écouter ce que les gens disent.
- Avez-vous le sentiment d’être un écrivain ?
- Pas plus aujourd’hui que jamais. A vrai dire, j’ai hâte d’en avoir finir avec les obligations que m’imposent ces prix et ces honneurs. La somme de 40.000 francs du Grand prix de la Ville de Genève, plus les 6000 francs du Prix Dentan, représente évidemment un sacré « paquet » pour moi, et je suis sensible à la reconnaissance, mais je me sens un peu écrasée par tout cela.
- Avez-vous de la peine à subvenir à vos besoins ?
- Je ne me plains pas. Lorsque mon père, résolu à en finir avec la vie, à l’âge de 82 ans, m’a appelée auprès de lui, il m’a dit qu’après sa mort j’aurais à me rendre à telle banque pour y retirer une certaine somme. Mon père, qui me refusait l’achat d’une paire de souliers lorsque j’étais adoéescente, y avait déposé pendant cinquante ans des bons de caisse, sur lesquels je vis encore… A présent, réconciliée avec lui, je vois mieux combien je ressemble à cet homme, si près de ses sensations immédiates, et qui avait des mots assez bruts, comme le sont mes pensées avant que je ne les police par les mots…
- Votre père et le Capitaine ont donc une ressemblance…
- Vous avez raison de faire ce lien. De fait, c’étaient deux êtres bruts de décoffrage, comme ont dit, avec une même force et une même pureté. Sans référence à Freud, je pense qu’il y a dans ma passion une recherche de mon père. C’est ce qui me faisait courir après cet homme. Dit comme cela, cela parait un peu vulgaire. Mais c’est bien de ça qu’il s’agit : d’ailleurs c’est très bien que, dans la vie, nous courions après quelqu’un…
 Cet entretien a paru dans l’édition de 24Heures du 17 avril 2007. Photo: Florian Cella.
Cet entretien a paru dans l’édition de 24Heures du 17 avril 2007. Photo: Florian Cella.
Catherine Safonoff. Autour de ma mère. Zoé, 2006.


 Cet entretien a paru dans l’édition de 24Heures du 17 avril 2007. Photo: Florian Cella.
Cet entretien a paru dans l’édition de 24Heures du 17 avril 2007. Photo: Florian Cella.
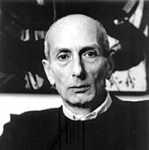 Marcel Cohen. Faits, II. Gallimard, 308p.
Marcel Cohen. Faits, II. Gallimard, 308p.