
J'étais là, telle chose m'advint

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.





Ce lundi 18 mars. - Il fait tout moche ce matin, ciel bas de plafond et morosité du monde selon les sales journaux, mais je n’en crois rien: je crois ce que je vois ou plus exactement ce que je vis et je revois alors les petits hier soir, les deux petits et la toute petite, et l’art vivant de la vie me convertit sans que je n’aie aucun besoin d’aucune théologie pour mieux le définir puisque tout m’est donné par la poésie et sa fille narquoise: la fantaisie.
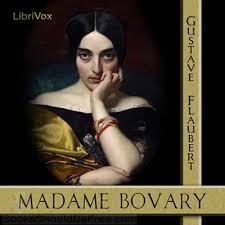
C’est précisément ce que je trouve ce matin dans les deux passages apparemment absurdes de Madame Bovary, après l’épisode de l’opéra: la scène frisant le grotesque de la voiture folle du fond de laquelle une voix lance des ordres au cocher pendant que dedans se passent des choses non détaillées, puis la scène non moins étrange des Homais lancés dans les confitures et la plongée dans le capharnaüm du pharmacien qui relève en somme du chaos biblique.
On ne voit pas assez la folie lucide de Flaubert, mais ce matin je la vois, aussi évidente que l’obstiné pigeon du rebord de la fenêtre sur cour qui semble me scruter de derrière la vitre , je vois la voiture folle tourniquer dans les rues et les environs de Rouen, je vois la bouteille bleue à bouchon jaune et contenu mortel dans le capharnaüm du pharmacien se la jouant Jupiter tonnant des Hébreux d’avant les Grecs, je me figure le Flaubert furieux dans son gueuloir et le soir il en fumera une sur le toit avec George Sand, puis je retrouve mes pieds nus de ce matin gris comme une pierre tombale, mes pieds de vingt ans plus vieux que ceux de Flaubert à sa mort (à 59 ans) alors que le beau-père d’Emma en avait 58 quand il a succombé à l’apoplexie au sortir d’un souper patriotique…

Ce mardi 19 mars. – Un méchante crampe me rappelle ce matin que je ne marche pas assez. Donc je me fixe aujourd'hui deux buts: marcher plus et boire plus d'eau. C'est d'ailleurs le programme que m'avait suggéré le Dr Noyau, mon angiologue résolu à lutter avec moi contre mon souffle au coeur, mes crampe musculaires et mes rotules rouillées...
Je suis redevable au jeune Adrien, mon petit-neveu du coté Hermana Grande, de m’avoir, par sa dissertation, ramené à mon université buissonnière, dont le séminaire consacré à Flaubert vient de s'amorcer, avec moi pour seul élève et Quentin au titre de correspondant libre, sur le thème, précisément, de Bovary et du bovarysme. La lecture du nouveau roman inédit de mon jeune confrère (comme on dit chez les séniles du milieu dont je ne suis guère) est d'ailleurs éclairée par l'intelligence de l'affreux Gustave, autant que pas sa lecture d'Aragon...
Quant à la lettre que j’ai adressée à Adrien l’autre jour, qui en a pris livraison chez son abuelita, je la relis en la recopiant/collant ici: « À La Désirade, ce jeudi 14 mars 2024, Mon cher Adrien, Grand merci, d’abord, de m’avoir adressé le texte de ta dissertation consacrée à Madame Bovary, et plus précisément à ce qu’on appelle le « bovarysme », que ton prof a raison de distinguer du « procédé » que tu relèves, s’agissant plutôt d’une disposition existentielle plus générale, laquelle était à la fois partagée et critiquée par Flaubert lui-même et procédant d’une déception initiale devant le monde, vécue par l’enfant Gustave avant de l’être par la jeune Emma.
Le « bovarysme », en gros, serait la fuite devant l’insupportable réalité de ce qu’on peut dire le poids du monde, à quoi l’on opposerait un monde idéal ou idéalisé, le « bovarysme » serait en somme le refuge dans lequel se replierait une personne trop sensible ou trop fragile pour « faire avec » la vie, le « bovarysme » serait, par extension, une sorte de rejet du monde réel et de ses servitudes, comme on le verra notamment chez Emma avec sa petite fille dont elle ne s’occupe que lorsque ça lui chante.
Mais Emma se résume-t-elle au « bovarysme » ? Absolument pas, et c’est là que ça devient intéressant, à la fois par ce qu’elle vit en réalité en passant de la vie paysanne à la vie bourgeoise, ce qu’elle vit et refuse de vivre avec Léon (elle rêve de cet amour sincère et le fuit en le regrettant) , puis ce qu’elle vit avec Rodolphe (elle s’abandonne d’abord à sa passion puis se réfugie dans l’absurde opération de sauvetage du pied-bot d’Hippolyte) et tu poses la question juste de savoir comment Flaubert lui-même voit la chose, s’il défend le « bovarysme » ou s’il le critique et le condamne.
De ta dissertation, qui incite réellement à une réflexion élargie, je dirais d’abord qu’elle manque un peu d’une base concrète qui pourrait expliquer en quelques mots, au lecteur non averti, de quoi et de qui il s’agit dans ce roman, et ensuite qu’elle manque de détails, alors que Flaubert est le romancier le plus attaché aux détails et à tous égards, son écriture même étant un prodigieux réservoir de détails parlés ou écoutés ou vus ou perçus par la narine ou l’antenne vibratile, etc.
Le détail est d’abord la chose, et ensuite c’est le mot de la chose.
Le premier détail qui compte, s’agissant d’Emma autant que de Gustave, ou plus exactement du petit Gustave avant l’enfant Emma, c’est le premier regard de l’enfant sur le monde, et pour Gustave c’est le choc de la réalité vécue dans l’hôpital où règne le père, entre les mourants et les cadavres, les malades et les fous – tout un monde que le petit garçon voit tous les jours autour de lui et qu’il observe avec sa sensibilité exacerbée, son intelligence déjà aux abois et ses défenses propres vu que c’est dès ses dix ans un vrai singe, un petit amoureux excessif, un Don Quichotte virtuel impatient d’en découdre avec les moulins à vent, un metteur en scène de théâtre, un acteur à multiples masques, un ange fasciné par la laideur du diable, enfin un peu tout et le contraire de tout comme le sont les vrais écrivains et comme le sera d’ailleurs Emma : adorable et puante bonne femme sautant de tout à son contraire et dont Flaubert dira : cette idiote merveilleuse éprise d’idéal le matin et le reniant le soir, c’est moi.
On a pris ça, souvent, comme un paradoxe. Ce moustachu qui se prétend une femme, à quoi ça ressemble ? C’est évidemment un raccourci, mais il y a néanmoins du vrai dans ce constat, qu’on pourrait étendre à Léon et à Rodolphe quand ils confessent, chacun à sa façon, leur horreur de la médiocrité provinciale et leur aspiration à tâter de la vie parisienne (Léon) ou de préférer le bon sens à l’exaltation (Rodolphe), et tout ça Flaubert l’a vécu dès son enfance et toute sa vie de voyageur autour du monde et de sa chambre.
Quand Rodolphe, aux comices agricoles, traite les officiels d’imbéciles, c’est Flaubert qui parle, comme c’est lui qui parle avec Emma quand elle juge Charles ou ce sommital crétin de pharmacien. Tu verras mieux tout ça quand tu auras 27 ou 37 ans. J’en ai fait l’expérience après ma première lecture à 17 ans, y revenant à 47 et 67 ans, et c’est chaque fois un livre plus riche qu’on découvre en lui comparant sa propre vie…
Toi qui es d’orientation scientifique, tu peux apprécier mieux que d’autres le souci d’objectivité de Flaubert, qui lui a valu un premier procès. Parler d’amour comme il l’a fait a été jugé indécent, parce que c’était vrai. Le « bovarysme » est évidemment un mensonge romantique, et Flaubert le montre, le dénonce implicitement en le montrant, mais avec des mots qui disent aussi la poésie d’Emma, la poésie des gestes et des mines d’Emma, la beauté soyeuse des regards et des rêveries d’Emma, et ça c’est le roman, mon cher Adrien, le grand roman dans lequel tous les personnages ont raison, y compris le lecteur de 18 ans…
Madame Bovary est le premier grand roman de Flaubert, après lequel il y aura L’Éducation sentimentale, qui étend l’observation à toute une société en évolution par la révolution, puis Bouvard et Pécuchet qui sera le summum de la critique de Flaubert contre les prétentions de la Science-pour-les nuls…
Je ne sais si tu reviendras, au cours de tes études et explorations, à ce furieux énergumène de Flaubert. Je lis ces jours La Vie dans l’univers du physicien rebelle Freeman Dyson, qui prend la littérature et la spiritualité très au sérieux, au point de lui consacrer le dernier chapitre de son essai. La vie de l’esprit n’est pas réductible à des équations, mais le pauvre Homais piétinait aussi en réduisant la religion à des platitudes obscurantistes ou moralisantes, et Flaubert à cet égard était plus religieux que le curé débitant ses insanités auprès du pauvre Hippolyte souffrant le martyre.
Si Flaubert est madame Bovary, il est aussi le pauvre Charles et l’horrible Lheureux dont il sent la bassesse comme une blessure personnelle. Si Flaubert est si drôle et si cruel à la fois, c’est parce que la vie est comme ça, mais pas que. En fait il montre plus qu’il ne démontre, et n’a pas besoin de juger et de condamner comme on le fait aujourd’hui à tort et à travers.
Quand je peins des voleurs de chevaux, disait mon ami russe Tchekhov, je n’ai pas besoin de conclure qu’il est mal de voler des chevaux : cela va de soi si j’ai fait mon job. Pareil avec la pauvre Emma, dont l’horrible fin équivaut au jugement de la vie. Mais qu’on se rassure : la vie n’est pas qu’un arrêt de mort – et cela tu le sais, tu le vis bien…
Enfin attention, mon cher Adrien, au détail. Le secret vif de Flaubert, c’est le style, qui passe par le détail des mots libérés des lieux communs et de la langue de bois. Style absolument libre mais exigeant un immense travail. Tu connais ça: freestyle…Avec mon respect filial et mon affection… »
Comme il fait grand beau ce matin, je vais peut-être « bouger » pour marcher et m’aérer de concert. Peut-être Chamonix ? Ou peut-être Grindelwald ? Ma fidèle Honda Jazz en décidera pour moi...