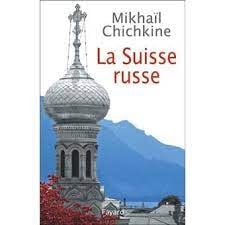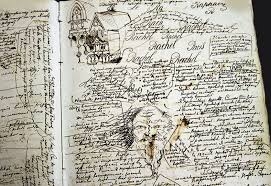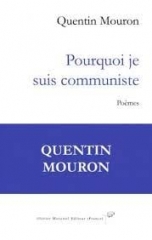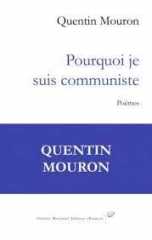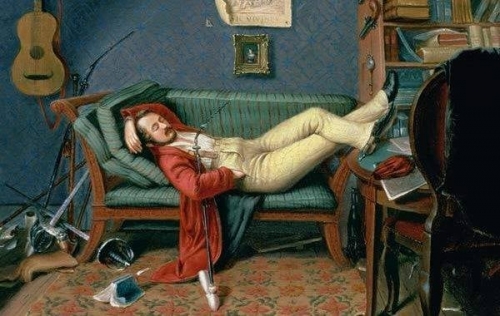
Des livres contre les bombes (10)
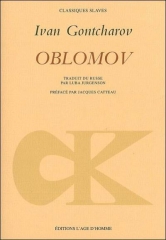
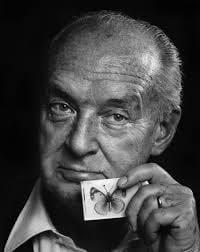

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
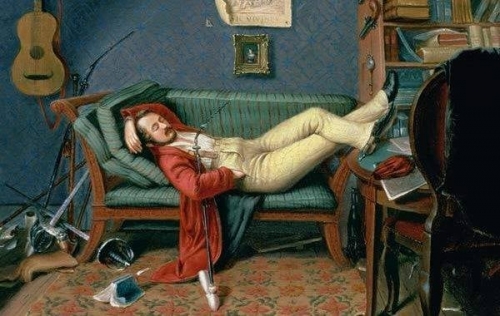
Des livres contre les bombes (10)
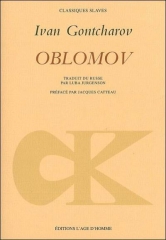
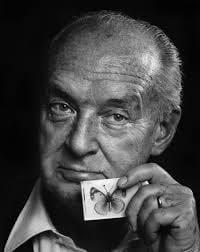


Des livres contre les bombes (10)
Dans Les Allées sombres d’Ivan Bounine, le grand écrivain russe passe les sentiments au filtre du temps et d’une poésie claire-obscure.
On entre dans ce livre par une sombre allée battue de pluie d’automne, le long de laquelle roule une lourde voiture couverte de boue – et c’est aussitôt comme l’image de notre propre course dans l’enfilade des années qui nous apparaît, avec le souvenir confus des saisons radieuses et des joues qu’on aimerait oublier à jamais ; et de même le vieux militaire qui débarque dans l’auberge accueillante qu’il y a là découvrant, en la personne de l’aubergiste, la femme qu’il a aimée et abandonnée trente ans plus tôt (car ce n’était alors, n’est-ce pas, qu’une servante), nous semble-t-il l’incarnation symbolique de l’homme confronté, par delà les années, à ce que la vie lui a donné de meilleur.
À peine plus de cinq pages, et ce sont deux destinées ressaisies pour l’essentiel, toutes deux marquées par le même sceau de l'amour: cette intimité partagée, ces instants qu’on imaginait éternels, ces nuits d’été propices aux confidences et aux baignades secrètes, ces irrépressibles élans, folies de jeunesse ou plus tardives rencontres, comme autant de fugaces image du bonheur en ce monde.
Ce bonheur, Ivan Bounine l’a évidemment connu pour en parler si bien. Ainsi l’écrivain en exil évoque-t-il souvent la Russie de ses propres souvenirs avec un mélange de verve et de nostalgie, de lyrisme et de mélancolie qui localise en quelque sorte son paradis perdu. Mais pas plus qu’il ne se borne à l’anecdote passionnelle, Bounine ne se limite à la déploration de son exil. Aussi bien les histoires qu’il raconte sont-elles tissées de sentiments et de vérités universels, et sinon comment expliquer que, tous tant que nous sommes, nous nous reconnaissions dans ces pages qui sollicitent à la fois les sens et l’émotion, l’expérience de chacun et sa vision du monde ?
Au demeurant, nulle spéculation désincarnée dans ces nouvelles, ni la moindre morale plaquée, mais une sorte de mosaïque qu’on pourrait lire en trois dimensions, où l’art de l’écrivain emprunte tour à tour à la rapidité du cinéma, à la magie suggestive de la musique et aux pouvoirs expressifs de la peinture, avec de constantes inventions du point de vue du récit.
Amours incarnées
Mais venons-en, plus précisément, à la substance de ces trente-huit nouvelles composées en France entre octobre 1938 et juillet 1944, dont certaines tiennent en une page et qui forment un tout organique en dépit de leur grande variété de ton et d’atmosphère. Nous l’avons dit : l’amour en est l’élément fondamental. Or ce qu’il faut souligner, c’est, à tout coup, l’enracinement charnel de ces rencontres d’un érotisme souvent intense, voire à la limite du scabreux, que Bounine évite de franchir par compensation d’émotion. Certaines de ces étreintes sont aussi frustes et violentes que celles de l’ours « Pélage de fer », violeur redoutable de la légende russe. Mais ce n’est certes pas un paradoxe que des situations combien triviales puissent inspirer des sentiments plus délicats... À égale distance des clichés édulcorés et de la fausse hardiesse contemporaine qui ne révèlent plus rien force de vouloir tout montrer, Bounine se fait en somme le chantre sans préjugés de ces amours qui ne sont pas forcément les premières ni les seules, mais dont le souvenir nous reste avec une intensité sans pareille. Cela peut ne tenir qu’à des riens : au grain velouté d’une peau, à la beauté d’un corps, à l’aura d’un visage ou au reflet troublant d’un regard.
Il n’en faut pas plus, assurément, pour faire perdre la tête aux petits étudiants que nous trouvons dans Antigone, dans Zoé et Valérie ou dans l’admirable Nathalie. Mais ajoutons, à propos justement de ces trois nouvelles restituant l’atmosphère quasi mythique des vacances russes à l’ancienne, que le charme de celles-ci compte aussi pour beaucoup dans l’éclosion de ces passions juvéniles, donnant lieu à des évocations qui rappellent à la fois la plénitude sensuelle de Tolstoï et la grâce mélancolique de Tchékhov. Soit dit en passant, rappelons que tels étaient les deux maîtres dont se réclamait Bounine, qui les égale parfois à bien des égards.
Ombres et lumières
Ainsi que le note pertinemment Jacques Catteau dans son excellente préface, « Ivan Bounine pressentait l’oubli, l’ombre froide et mystérieuse du caveau, et pourtant, dans le même temps, il œuvrait à la chaude journée d’été de la vie ». Sans la trempe du Tolstoï « métaphysicien », et beaucoup moins sombre que ne le devint Tchékhov, le premier Nobel de littérature d’origine russe (en 1933, au dam du pouvoir stalinien) réalise une manière d’équilibre dont les relations qu’il entretient avec ses personnages sont peut-être la meilleure illustration.

De fait, Bounine est capable de parler d’une grisette moscovite avec la même attention amicale que celle qu’il voue à tous les autres, fussent-ils artistes ratés ou généraux en retraite, demeurés obscurs (la terrible nouvelle intitulée L’idiote, où l’on voit un jeune séminariste engrosser la cuisinière de la maison avant de l’en faire chasser avec l’avorton qu’il lui « donné »), ou brillants exilés.
De même, cette équanimité préside aux rapports que l’écrivain entretient avec les lumières et les ombres de l’existence humaine. Mélange de chaleur et de lucidité, son regard fait part égale aux surprises de l’amour et à ses revers. Les femmes (dont il faudrait détailler la frise magnifique des portraits) ne sont pas toujours victimes, loin s’en faut, pas plus qu’elles ne sont toutes fatales.
Des cartes de visite...
Certaines de ces histoires semblent finir bien, comme Une vengeance où, contre toute attente, deux êtres éprouvés par la vie s’aperçoivent qu’ils sont faits l’un pour l’autre. D’autres s’achèvent tragiquement comme Galia Ganskaïa, ou tristement, comme ces deux joyaux que représentent Paris et Premier lundi de carême. D’autres encore ne finissent pas : un jour sur un bateau, le grand écrivain X. rencontre la charmante Y., dont le rêve d’enfance était de se faire faire des cartes de visite... et la prochaine escale de les séparer après une seule nuit de volupté, les laissant tous deux « avec cet amour que l’on garde à jamais blotti au fond du cœur ». Entremêlés avec un art suprême, les thèmes de l’amour, de l’exil, de l’errance et de la mort constituent ainsi la trame vivante et vibrante des Allées sombres, dont les résonances nous touchent infiniment.
Journal des Jours maudits
Au lendemain de la révolution bolchévique, du 1er janvier 1918 au 20 juin 1919, Ivan Bounine tint un journal. À l’approche de la cinquantaine, le futur premier Nobel russe de littérature (en 1933) était déjà reconnu comme un classique de sa génération, auteur d’une fresque dans laquelle il avait décrit les rudes aspects de la vie des moujiks (Le Village, 1909) et qu’on aurait pu dire le triple héritier de Tolstoï pour le style, de Tchékhov pour son attention aux humiliés, ou encore de Tourgueniev pour sa pénétration des sentiments les plus délicats.
De ce dernier aspect, la meilleure illustration a été donnée par Les années sombres, datant de l’exil et constituant son livre préféré et son chef-d’oeuvre.
Dans ces Jours maudits, nous découvrons un honnête homme confronté, au jour le jour, à un ouragan social et moral qui ravage tout ce qu’il a aimé au nom d’un « Avenir radieux » dont il voit immédiatement quels abus et quels simulacres il camoufle.
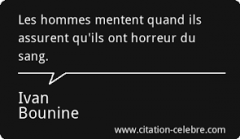
Aux premières loges, il note que les Bolchéviks sont les premiers stupéfaits du succès de leur putsch. Et puis il observe le simple comportement des gens, le changement du langage et des visages. Car tout à coup se manifestent cet élan, cette arrogance, cette hargne, cette vindicte qui lui font noter : « Un langage est apparu, tout à fait nouveau, spécifique, composé exclusivement d’exclamations grandiloquentes mêlées à des injures grossières ». Et de repérer les nouveaux arrivistes, les délateurs, les profiteurs opportunistes, les salopards qui vont s’auto-proclamer commissaires politiques et proclamer leurs épouses femmes de commissaire politiques…
Le premier il dénonce l’imposture de cette rhétorique qui dit que « le peuple a dit ! ». Contre les poètes flirtant avec la Révolution, les Blok et les Maïakovski, il se déchaîne : « Ô fornicateurs du verbe ! Des fleuves de sang, des mers de larmes, mais rien là qui les touche ! ». Ainsi se fait-il le témoin de cette tragédie, inébranlable et atterré, par fidélité à un monde conspué. En attendant de survivre ailleurs, une pierre au cœur…
 Ivan Bounine. Les Allées sombres. L’Âge d’Homme, 1988.
Ivan Bounine. Les Allées sombres. L’Âge d’Homme, 1988.

Ivan Bounine. Jours maudits. L’Âge d’Homme, 1988.