« Partout où qu'elle soit dans le monde, une femme ne doit pas quitter le lit de son mari même si le mari l'injurie, la frappe ou la menace. Elle a toujours tort. C’est ça qu’on appelle les droits de la femme». (Ahmadou Kourouma)
J'avais rêvé que la nuit d'Afrique à gueule de crocodile m'avalait, comme Milou en est menacé dans Tintin au Congo, puis le sourire de ma bonne amie a éclairé mon réveil, j'ai bouclé mes valises, nous nous sommes quittés devant la gare le coeur un peu serré, elle m'a dit de penser à elle et j'ai souri en me disant que nos anges gardiens puisent en nous leur propre force et déjà j'avais les tripes et le coeur en Afrique avant d'y mettre le premier pied, me replongeant, en train, dans la lecture des Mathématiques congolaises d'In Koli Jean Bofane entreprise la veille, le tendre paysage de La Côte défilait aux fenêtres et je me trouvais entraîné dans la gabegie savoureuse et violente à la fois de Kinshasa, je voyais passer les villas de nababs du bord du lac et je lisais la scène atroce du gosse massacré par le sergent-chef Personne chargé de driller les enfants-soldats, enfin je débarquai à Geneva Airport et retrouvai mon compère Max le Bantou avec lequel je me trouvais investi de la « haute mission », c'était marqué sur un papier, de représenter la Confédération helvétique au Congrès des écrivains francophones à Lubumbashi, en République Démocratique du Congo - et Max me disait que son ange gardien à lui, sa mère à Douala, lui avait recommandé tout à l'heure au téléphone de ne pas oublier d'emporter là-bas « La Parole »...
À l'annonce du retard conséquent de l'avion de Rome nous n'avons pas bronché, avec Max le Bantou, notre commune passion du jeu gratuit, qui s'ajoute à notre goût partagé pour les histoires à n'en plus finir, nous ayant portés vers l'improvisation ludique combinant le damier de carton et les capsules de bière et de limonade, et c'est ainsi que le temps a passé jusqu'à la prochaine attente dans les couloirs marbrés de Fiumicino aux boutiques de luxe et aux bars outrageusement fermés après dix heures du soir, autant dire que nous nous impatientions de toucher bientôt à des rivages moins clinquants, et bientôt nous nous étions retrouvés suspendus dans le silence chuintant de l'avion éthiopien destination Addis-Abeba et, par delà la longue nuit, fantômes enveloppés de couvertures aux bons soins de veilleuses stylées, nos paupières s'étaient relevées sur le jour se levant dans le ciel congolais, et là-bas la terre montait peu à peu vers nous bien rouge, aux essaims de maisons oranges - pour la première fois l'Afrique noire m'apparaissait du ciel en ses couleurs chinées...

Et tout de suite, touchant terre dans la touffeur de Lubumbashi, anciennement Elisabethville en son avatar colonial, m'a ravi le chaos organisé de cette Afrique-là, ah mais nos bagages étaient-ils arrivés, se trouvaient-ils dans l'entassement pyramidal jouxtant le tapis roulant ne roulant plus depuis longtemps, n'y avait-il pas de quoi s'inquiéter ? mais non car dix, vingt, trente lascars aux gilets marqués de l'enseigne KATANGA EXPRES s’agglutinaient de toute part et nous pressaient de leur confier la recherche de nos précieux bagages moyennant quelques poignées de dollars, et voilà que surgissait, rayonnant du plus alerte sourire d'accueil, le bien nommé Chef du Protocole mandaté par le Congrès et se réjouissant de nous identifier non sans s'inquiéter de l'absence du troisième éminent scribe annoncé en la personne d'un certain Fiston...
Mais n'avais-je pas rêvé ? Ce Congrès congolais se tiendrait-il jamais ? Ce M. Fabrice Sprimont qui était censé nous recevoir, auquel j'avais écrit à Kinshasa et qui ne répondait pas, existait-il seulement ? Et s'il était vrai que la malaria l'avait terrassé au point de remettre déjà d'un mois le colloque, celui-ci ne restait-il pas aussi aléatoire que le Sommet de la francophonie qu'on disait battre de l'aile ?
Je m'étais posé ces questions au moment de me faire inoculer cinq vaccins. Je me les répétai dans l'antichambre du Ministre chargé de me délivrer mon visa. Mais voici que nous nous retrouvions, ce premier soir de notre séjour au Katanga, à la table du Safari Grill du mythique Park Hotel de l'ancienne cité coloniale, en face de ce Monsieur Sprimont, Conseiller à la Communauté française de Belgique, dont l'accueil immédiatement avenant m'a d'autant plus rassuré que le personnage, de toute évidence, manifeste autant de compétence aux affaires que d'entregent convivial.
Les Belges sont étonnants. Il reste évidement de l'Afrique dans leur complexion physique et spirituelle, et je ne sais ce qui m'a fait penser aussitôt aux romans africains du Liégeois Simenon en observant le Conseiller, dont le bouc et l'espèce de détachement très attentif m'ont rappelé aussi mon cher Anton Pavlovitch Tchekhov, figure tutélaire de ma Russie personnelle.
Or cette double ressemblance était liée aussi, sans doute, à cette impression que le Conseiller, à mes yeux, émargeait probablement à l'espèce de ceux qui, d'une manière ou de l'autre, ont pris la tangente, passant ce que le Simenon de La Fuite de Monsieur Hire appelle la ligne rouge.
Ensuite notre conversation m'a confirmé dans le préjugé favorable que m'inspirent les irréguliers, je veux dire: les aventuriers organisés que sont le plus souvent les gens d'entreprise ou de culture expatriés, artistes et parfois espions, nostalgiques d'une vie meilleure ou fuyant un passé dévasté; à cela s'ajoutant la culture réelle, non plaquée, humainement éprouvée, et l'humour de Fabrice qui, tout de suite, nous a épatés le Bantou et moi.
Quoique détestant les palaces, et ceux des pays pauvres plus que les autres évidemment, je me suis trouvé presque à l'aise dans le Park Hôtel aux chambres immenses et aux vérandas suggérant autant de veillées coloniales. Et du coup je me suis rappelé tant d'ambiances de romans ou de films dont il ne restait ici que le décor surplombant, dans la nuit avancée, la rue aux ombres plus ou moins menaçantes des prédateurs urbains.
Le Park Hôtel date de 1929, quelques années après le voyage au Congo de Gide et du jeune Marc Allégret, qui y tourna un film tandis que l'écrivain y établissait ses réquisitoires. Cependant nous voici bien loin du grand humaniste aux indignations de bourgeois en rupture de conformité: près d'un siècle après son Voyage au Congo, la parole est bel est bien aujourd'hui aux Africains et je suis là pour les écouter.
Après le Dinner très cool avec le Conseiller, plus que vannés par le voyage et la longue journée, il nous restait, avec Max le Bantou, à réviser notre speech commun du lendemain dont nous venions de découvrir le motif établi à notre insu et proposant «Le défi de la langue et du langage aujourd'hui; rapport avec la langue française et les langues partenaires»...
Mais qui donc nous avait collé cette expression babélienne de «langues partenaires », et qu'aurions-nous diable à disserter à ce propos, s'inquiétait mon jeune Camerounais au bon sens éprouvé ? Que dalle! lui répondis-je tout de go. Langue de coton de papas universitaires ! Ils proposent et nous disposerons: nous parlerons de nos parlures et de nos façons à nous de lire et d'écrire en nos périphéries dans la langue de Rabelais et de Voltaire qui est celle aussi d'Aimé Césaire et d'Amadou Hampâté Bâ, où tous nous sommes propriétaires et partenaires à la fois, à grappiller de concert à l'arbre aux mots pour en faire notre miel millénaire…
Nous avions droit au prime time matinal des tables rondes arrangées en carré, c'était bien de l'honneur pour deux émissaires black'n'white de la Suisse qui lave-plus-blanc comme on sait, nous nous étions promis, avec Max le Bantou, de rester simples et vrais autant que faire se pouvait, je parlerais des transits féconds entre nos régions aux parlures variées, Max dirait à sa façon comment il vit la multilangue française entre Douala et le quartier des Pâquis de la Geneva International, déjà les micros grésillaient et tourniquaient les caméras aux épaules, déjà j'avais repéré les soeurs Courage appelées par l'omniprésent organisateur André Yoka au commandement des débats suivants, bref la journée était lancée et je ne sais pourquoi, à ce moment-là, le souvenir des Katangais de mai 68 dans les couloirs de la Sorbonne m'est revenu - je voyais en face de moi le jeune Fiston Mwanda Mujila qui n'avait pas dit mot aux débats de la veille - le trentenaire n'était pas né alors que je lisais Les damnés de la terre à mes vingt ans -, je voyais à côté de lui Jean Bofane dont j'avais lu quelque pages de plus la nuit passée - il avait douze ans en cette année où nous errions dans le Temple de la culture française avec nos mines farouches d'apprentis révolutionnaires -, je revoyais ces parias de la banlieue parisienne débarqués aux barricades et qu'on appelait alors, je ne sais pourquoi, les Katangais, il y avait de ça plus de quarante ans, autant d'années que celle qui me séparaient sans me séparer des vingt-cinq ans de mon compère le Bantou...
Elles n'en finissent pas de nous ramener sur terre, nos mères et nos frangines, nos amantes et nos amies, nous avons le miel des mots aux lèvres et malgré leur romantisme invétéré elles n'en finissent pas de nous rappeler le sel et le sol de la vie, et là je les voyais une fois de plus couper court au choeur des « y a qu'à » et des « il faut », nous écoutions donc Bestine et Ana, qui oeuvrent toutes deux sur le terrain d'Afrique, et Dominique venue de Liège, et je me disais que sans elles rien ne se ferait qui doit se faire à partir de rien, avant même que rien d'institué se fasse, car c'était de cela qu'il s'agissait bel et bien: combien de librairies en ces lieux, quelle politique du livre et de la culture au Katanga et dans l'entier Congo, quel appui aux écrivains et à la chaîne des passeurs, or elles arrivaient avec leur expérience concrète de telle ou telle réalisation, l'heure n'était pas au lamento que nous connaissons aussi aux pays de la profusion, le moment n'étais pas non plus à se donner bonne conscience, le temps de cet improbable congrès était aux débats fondés en réalité lançant les premiers ponts de possibles actions de demain.
Or on aura tout entendu ce jour-là, de professeurs ou d'auteurs arrivés des quatre vents de l'Afrique francophone ou des lointains européens. Florent le Béninois reconnu, Sami le Togolais consacré, Jean le Congolais non moins auréolé de succès ont parlé la langage de ceux qui ont la double expérience du dénuement et de la saturation, proposant autant de bons exemples de développement, et tous ensuite auront témoigné pêle-mêle avec force arguments et bonne volonté à n'en plus pouvoir, m'évoquant une pièce de théâtre se donnant sur une scène cernée par les étudiants tenus à l'écart derrière lesquels j'imaginais la multitude des gens sans livres mais pleins de mots - un notable universitaire a daubé sur le fait que ses étudiants affirmaient lire en français sans comprendre rien, un écrivain invoquait le droit à ne pas être surveillé dans ce pays et tel notable soucieux de bienséance l'a mouché vite fait , tel autre prônait l'encouragement de la langue vernaculaire, tel invoquait la pratique des langue jumelées, l'oubli des auteurs locaux fut pointé et mouché lui aussi de dédaigneuse façon, bref c'était la joyeuse confusion des généralités et des mâles péroraisons échappant à nos soeurs Courage, mais enfin quoi n'était-on pas dans un colloque littéraire, enfin le même soir nous nous sommes tous retrouvés au lieu vibratile de la Halle de l'étoile, aux bons soins de cet autre échappé des conformités qu'incarne le directeur de l'Institut français au joli nom de Dominique Maillochon, et ce furent alors des transes belles ou ce slam de haute volée nous rappelant que le langage exprimant la réalité, et la langue-geste, ne passent pas que par les filtres de l'élite pensante et parlante en sa trop fameuse « instance de consécration »...
Un malingre philosophe allemand à moustache de paille de fer disait ne pouvoir croire qu'en un dieu qui danse, et je serai le dernier à le railler car là gît bel et bien le secret de l'homme aux semelles de style qui est tout mouvement et toute grâce vivante, je me le disais tout au long de cette soirée à la Halle de l'étoile à les voir danser et raper et chanter et slamer, les garçons sauvages et les filles souveraines, à nous retremper dans nos forêts ancestrales, à nous relancer dans la ville-monde aux semelles de rail, selon l'image de Fiston Mwanza Mujila qui me racontait la galère sans espoir des jeunes en sa ville-pays: à peine y était-il revenu depuis quatre années qu'il en repartirait, mais ce soir-là c'était à danser qu'il pensait entre deux apartés et c'était à danser que tous nous aspirions après avoir tant parlé et parlé...
À l'aéroport d'Addis-Abeba j'étais resté longtemps à observer, moi le mécréant paléochrétien frère en Christ des fils de Niambe et de Loba, les fidèles musulmans se recueillant dans cet Espace Prière où ils s'agenouillaient après de brèves ablutions à jolies théières d'eau du robinet des lieux d'aisance d'à côté, femmes gracieuses et jeunes gens décents, époux séparé de l'épouse, et je n'éprouvai pour eux que respect quand les flagellants et autres talibans ou foudres de Klan m'insupportent et me hérissent de quelque culte qu'ils se réclament - je ne voyais de ceux-là que l'aura d'humilité avant de tomber, dans l'avion de Lushi, sur ces deux élus du seul Seigneur évangélique de la Pentecôte arborant leurs uniformes d'hommes-sandwiches du Dieu triomphant au rictus de tiroir-caisse...
Et dansant avec ceux de l'étoile je me suis retrouvé lisant Dans la peau d'un noir, adolescent révolté de seize ans, Bestine l'avocate ondulait comme une prêtresse de la forêt, Jean Bofane démantibulait son ndombolo en roulant ses yeux de bille noire, Fabrice le décolonisé s'africanisait en déhanchements élégants, enfin tout se stylisait à l'avenant sous le regard de sphinx noir de Sami Tchak, tout était mouvement et fusion devant les effigies affichées de toutes les Femmes d'Afrique en mémorial éclatant - de Reine Pokou en Sarrouina ou de Mariama Bâ en Zena M'dere du Commando des chatouilleuses -, et je me figurais l'échappée rêvée dans le noir que ce serait, plus tard, de cette ville-pays et en toutes les villes-mondes à greffer et revivifier nos pensers et nos langues - notre corps nombreux dans le multimonde...
L'aube poignait au troisième jour du Congrès subtropical, j'entendais la rumeur montante de la rue populaire de derrières les voilages protecteurs de la chambre immense de l'ancien hôtel colonial et je me demandais ce que diable je foutais là, à quoi rimait notre présence en ces lieux, le sens de tout ça sous le froid éclairage de la lucidité décapée d'avant le retour à la vie ordinaire et à ses comédies ; je pensais au Congo des effrois, je me rappelais le Kivu, les affreux reportages, les messages de mon ami Bona, je me rappelais mes doutes vertigineux de certain autre congrès du PEN-Club international en 1993, sous les falaises croates de la guerre où les écrivains avaient dansé comme des ours de propagande, je pensais aux virulentes oppositions au prochain Sommet de la francophonie à Kinshasa et je me disais que tout de même, que peut-être, qu'être là valait peut-être mieux que de n'y être pas, je me rappelais nos propres combats séculaires pour un peu plus de liberté et de libre pensée, tout ce qu'à travers les siècles nous avions appris, tout me revenait pêle-mêle de notre histoire et de nos alternances d'ombre et de lumière, comment nos livres pouvaient exister aujourd'hui et circuler, et quand même, par conséquent, comment nous pouvions modestement en témoigner en ces lieux où tout restait à faire...
Or au cours de ce jour on avait parlé d'abord de tourisme, on allait voir peut-être le lion vivant ou l'okapi, le girafon ou le gnou du fameux zoo de Lubumbashi, on irait peut-être dans les collines surplombant les anciens terrils, aux terres de la Ferme Espoir du Président ou aux domaines pilotes du Gouverneur, et puis non, les projet s'était réduit au fil des heures, remplacé par la visite solennelle, et donc sapée et cravatée, à la seule Excellence locale, aussi tous les écrivains s'étaient-ils faits jolis, j'avais hésité à y couper mais mon compère le Bantou m'avait objurgué que je ne pouvais louper un tel spectacle, ainsi m'étais-je procuré vite fait chemise d'apparat et cravate associée, avais-je lustré mes boots à la lotion capillaire et m'étais-je brumisé au parfum social, ainsi tous s'étaient-ils pimpé l'apparence afin de faire honneur aux Lettres francophones à la réception de l'avenant Moïse Katumbi Chapwe, aussi connu comme homme d'affaires éclairé qu'en sa qualité de Président du club-vedette de foot Mazembé (Impossible n'est pas Mazembé !) et nous recevant sans grande protection, souriant, à l'aise, charmeur, jurant que la Littérature lui est chère après avoir colmaté, dit-on, pas mal de carences des institutions scolaires et de nids de poules sur les voix d'accès aux collèges et facultés...
On aura donc bien disserté tous ces jours, on aura crânement entonné l'Hymne du prochain Sommet de la Francophonie, on aura psalmodié « Chantons en choeur notre riche diversité / Oui chantons Francophonie et Fraternité », on aura repris comme ça: « Ah! Il est si merveilleux notre monde / Tambourinons ses rythmes à la ronde », on aura vécu cette comédie et voilà que, dans les coulisses de ce théâtre-là, nous nous serons rencontrés, quelques-uns et même plus, nous aurons réellement échangée des idées et des vues, des livres, des documents, des projets, quelques amitiés peut-être durables seront peut-être nées par delà les solennelles déclarations d'intention et autant d'« il faut » que d'« y a qu'à », oui peut-être, quand même - peut-être tout ça n'aura-t-il pas été que words, words, words...











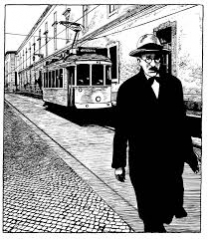






 (Pour Annemarie et feu son Giovanni)
(Pour Annemarie et feu son Giovanni)











 Mais un vilain verrou, bouclant une haute grille, interdit l’accès de la petite église hors-les-murs de San Nicola, qui nous tient ainsi à distance du Cruciflé, là-bas, tout émacié mais de bois dur ivoirin, taché de sang et la peau déchirée par le fouet et les bâtons, quelque chose du supplicié de Grünewald ou de quelque autre maître ancien arrachant la scène à toute sensualité pour exacerber l’expression de la Douleur mais sans pathos de théâtre pour autant – même de loin on perçoit cette figure de vérité que le cadenas protège probablement des immondes pillages de sbires d’antiquaires…
Mais un vilain verrou, bouclant une haute grille, interdit l’accès de la petite église hors-les-murs de San Nicola, qui nous tient ainsi à distance du Cruciflé, là-bas, tout émacié mais de bois dur ivoirin, taché de sang et la peau déchirée par le fouet et les bâtons, quelque chose du supplicié de Grünewald ou de quelque autre maître ancien arrachant la scène à toute sensualité pour exacerber l’expression de la Douleur mais sans pathos de théâtre pour autant – même de loin on perçoit cette figure de vérité que le cadenas protège probablement des immondes pillages de sbires d’antiquaires…

