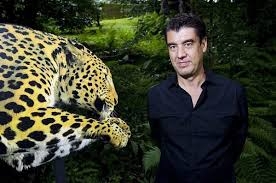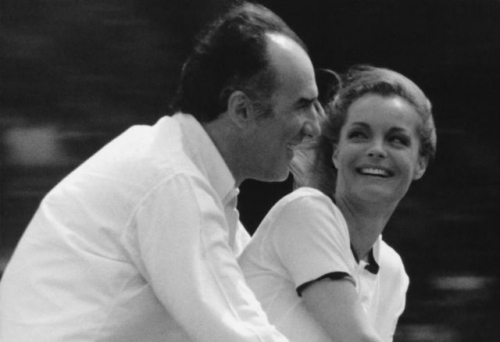


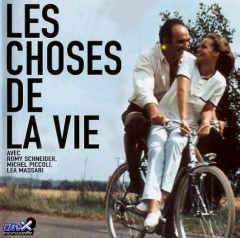

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
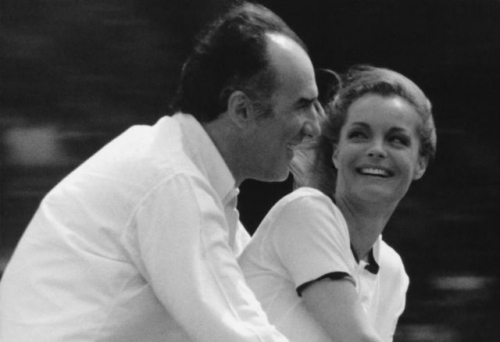


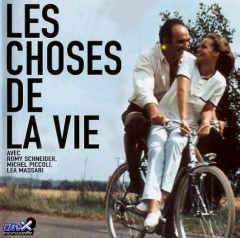


À propos de La Passion de transmettre, recueil d’entretiens de l’historien Alfred Berchtold avec JLK, paru en 1997 à la Bibliothèque des Arts. Gilbert Salem lui avait consacré la DER de 24 Heures. Alfred Berchtold, surnommé Pingouin par ses petits camarades de la communale de Montmartre - où il séjournait à cause des activité professionnelles de son père -, fête aujourd'hui ses 93 ans ! Joyeux anniversaire Monsieur Berchtold !!!
Né à Zurich en 1925, Alfred Berchtold a passé sa prime jeunesse à Paris. L'auteur de LaS uisse romande au cap du XXe siècle vit depuis plus de cinquante ans à Genève. Son esprit méconnaît donc toute frontière.
Autant l'interview journalistique devient quelquefois un exercice de routine, vite bâclé, vite écrit, vite lu et qui frustre généralement les personnalités qui s'y adonnent (et par conséquent le lecteur), autant l'entretien qui paraît sous forme de livre peut être conçu,s'il est bien conduit, comme un genre littéraire à part entière. Notre confrère Jean-Louis Kuffer, chroniqueur littéraire à 24Heures, vient d'y exceller en donnant carte blanche à Alfred Berchtold, l'un des derniers érudits suisses à la mode humaniste, l'auteur de deux sommes essentielles sur l'histoire intellectuelle de notre pays: La Suisse romande au cap du XXe siècle, portrait littéraire et moral(1963), et Bâle et l'Europe, une histoire culturelle (1990)*.
 «A l'heure, écrit Jean-Louis Kuffer, des antinomies stériles qui opposent indifférents et fanatiques, prétendus avant-gardistes et supposés rétrogrades, nationalistes chauvins et détracteurs systématiques d'une Suisse caricaturée, Alfred Berchtold tient une position qui est moins celle du confortable juste milieu que d'un équilibre sans cesse réajusté.»
«A l'heure, écrit Jean-Louis Kuffer, des antinomies stériles qui opposent indifférents et fanatiques, prétendus avant-gardistes et supposés rétrogrades, nationalistes chauvins et détracteurs systématiques d'une Suisse caricaturée, Alfred Berchtold tient une position qui est moins celle du confortable juste milieu que d'un équilibre sans cesse réajusté.»
Esprit affranchi de toute théorie, allégé par un humour naturel bienveillant et sans cesse émoustillé par unesaine curiosité, il s'intéresse non seulement aux œuvres mais aussi aux hommes qui les ont faites. Il se passionne d'une manière générale pour les gens. C'est ce qui transparaît de mieux dans ce livre d'entretiens où l'on aborde les sujets les plus graves d'un ton enjoué.
«Petit garçon, dit-il, plutôt que de jouer avec des copains de mon âge, je me plantais dans les squares à l'écoute d'un groupe de commères.»
Plus tard, quand il alla à larencontre des peintres et des écrivains, Berchtold éprouva beaucoup de joie à découvrir leurs caractères, leurs tempéraments, leurs silhouettes. «La concentration dans la diversité caractériserait peut-être ma démarche. Résumons:mon bonheur a été d'épier et de signaler le passage du poète (au sens le plus large du terme, je veux dire: du créateur) à travers nos cités et nos villages,et jusqu'au-delà des mers.»
Né à Zurich le 17 juin 1925, Alfred Berchtold est né dans une famille de souche paysanne. «Or, la paysannerie, si proche, était déjà loin de nous.» Son grand- père était juge cantonal, maire et historien; son père était directeur commercial à la fabrique Landis & Gyr, à Zoug, et fut chargé de créer une représentation générale à Paris. C'est ainsi que cette famille de Zurichois vécut durant quinze ans dans le XVIIIe arrondissement, au pied d'une butte Montmartre encore envahie par les chèvres et dans la proximité du Moulin de la Galette.
«Une enfance parisienne m'a été donnée, dit-il, qui m'a épargné pour toujours le «traumatisme», allègrement cultivé par certains, d'avoir grandi dans une «geôle helvétique» en rêvant d'évasion.» (Plus tard, il exprimera d'ailleurs une nette réticence à l'égardde la fameuse métaphore de Dürrenmatt, dans sa lettre à Vaclav Havel, évoquant la Suisse comme une prison sans murs dont les habitants sont leurs propres gardiens).
«La propension d'un de nos censeurs indigènes à prendre l'étranger à témoin me paraît manquer de loyalisme et de tact...»
Après avoir fréquenté le lycée Condorcet — où il s'intéresse beaucoup à la politique française et mondiale — Alfred Berchtold revient avec les siens à Zurich, où il suit les classes du gymnase et obtient une maturité classique, débarque à Genève en 1944, assiste aux cours de Marcel Raymond, éprouve un choc décisif en écoutant ceux de René Huyghe à l'Athénée et à l'Alhambra sur la psychologie de l'art.
Et c'est au hasard d'une lecture sur Ferdinand Hodler, dans un quelconque Almanach du Voyageur en Suisse, qu'il trouve, le temps d'une illumination, les choix majeurs de son orientation pour les cinquante années à venir: «Désormais, ce pays (la Suisse donc) qui m'intéressait moyennement, et dont les vertus et les performances ménagères, potagères, fromagères, chocolatières et bancaires me laissaient assez indifférent, ce pays que je jugeais respectable mais plutôt terne, voici qu'il avait une signification sur la carte de l'Europe culturelle; voici que son histoire révélait des lignes de force, des constantes qu'il valait la peine d'étudier; elle promettait des rencontres aussi variées qu'inattendues.»
Après avoir passé sa licence en 1947, Alfred Berchtold travaillera durant treize ans à l'élaboration de sa thèse de doctorat, présentée en 1963.La publication, la même année, de LaSuisse romande au cap du XXe siècle suscitera d'abord de l'étonnement(l'histoire intellectuelle de la Romandie par un Alémanique de Paris, quelle gageure!), puis de l'admiration.
C'est une somme puissante qui narre, avec érudition et rigueur, mais aussi avec saveur et bagou, le grouillement extraordinaire d'une vie de l'esprit telle qu'elle s'est manifestée, en une région donnée, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe.
D'Amiel à Benjamin Vallotton, en passant par le délicieux Paul Budry, Cendrars, Cingria et Crisinel, et puis Gilliard, Pierre-Louis Matthey et tout spécialement Ramuz, sans oublier Roud, Pourtalès et Gonzague de Reynold, il brosse un tableau très coloré d'une période où les lettres, en nos contrées, furent particulièrement fertiles et variées.
Ouvertures sur le monde du théâtre,de la peinture, de la musique; ouvertures aussi sur la théologie protestante,sur les personnalités catholiques, les psychologues, les penseurs, les moralistes, les créateurs de revues littéraires. L'ouvrage compte près de mille pages et 3333 citations - c'est Madame Nicole Berchtold née Favre, sa meilleure collaboratrice, qui les a dénombrées...
En 1990, paraît un autre livre tout à la fois volumineux, exhaus tif et voluptueux à lire: Bâle et l'Europe.
«Pourquoi Bâle? Parce que la cité rhénane m'offrait un foyer admirablement concentré une situation géographique privilégiée et l'occasion de grands débats européens. À condition de monter et de descendre l'échelle des siècles, Bâle me permettait de rappeler combien, dans ce pays aux colorations diverses, nous sommes en Europe, quels que soient nos rapportsmomentanés avec telle ou telle institution internationale.»
«Votre situation d'œil extérieura-t-elle favorisé ou limité parfois vos investigations?», demande Jean-Louis Kuffer.
«Si je n'ai pas été formé en Suisse romande, je n'y ai pas été déformé, rétorque Berchtold. Mon approche d'un monde neuf pour moi en a peut-être été plus spontanée: j'abordais mes auteurs sans apriori, sans esprit de chapelle de séminaire académique ou de bistrot.»
La Suisse, Alfred Berchtold l'aime profondément, avec son cœur de poulbot qui lui est resté de Montmartre: «Cette Suisse où l'on est confronté sans cesse à l'autre, où, butant à chaque pas contreune frontière, on est amené sans cesse à dialoguer par dessus celle-ci.»
Alfred Berchtold: La Passion de transmettre, entretiens avec Jean- Louis Kuffer. Bibliothèque des Arts, collection Paroles vives, 180 pages. Les deux ouvrages susnommés d’Alfred Berchtold ont paru aux Editions Payot, à Lausanne.

Comment, cette année-là, et ce soir-là, cette nuit-là se mêlèrent voix et visages, dans un choeur dont les échos jamais oubliés resurgissent de loin en loin.
L’alto à tignasse de feu débarquait d’un trou perdu du Wisconsin, mais Jim situait sa seconde et véritable naissance en Californie, dans une communauté de San Francisco où il avait entrepris son voyage sur la Vraie Voie, cependant il n’y avait que quelque jours qu’il s’était attaché à la soprano moldave à la voix si poignante assise à côté de lui, Milena de son prénom, fille de réfugiés roumains installés à Londres, et Milena avait suivi Jim jusque-là sans être sûre de se lancer avec lui sur la route d’Orient, d’ailleurs ils avaient eu le matin même leur première rupture d’harmonie en faisant leurs ablutions sur le bord de la Limmat, lorsque Jim lui avait confié qu’il n’était pas sûr que la Vraie Voie pouvait se faire à deux, mais à l’instant leurs voix planaient ensemble au-dessus des moires de la rivière en se mêlant à celles des autres, on eût dit qu’il n’y avait plus d’espace ni de temps divisé, le choeur évoquait une espèce de grand essaim sonore en suspens entre les flots et le firmament d’été constellé de myriades d’étoiles qui rappelaient au vieux Max ses nuits des années 40 au pénitencier militaire, Max dont le drapeau de Marcheur de la Paix enveloppait les épaules de la douce Verena - la fluette voix du patriarche et celle un peu flûtée de la jeune fille dessinaient de fines arabesques en bordure des autres -, puis le quelque chose de très archaïque et de très juvénil qui émanait du choeur fut soudain comme électrisé par le solo de cristal limpide du berger Hans Sonnenberg descendu de son alpage avec de quoi se divertir au Niederdorf et que diverses filles de bar s’étaient arraché, mais qui pour lors n’avait d’yeux que pour la Roumaine de Jim, et c’était pour elle que sa voix cherchait à présent une faille vers le ciel qu’on imagine derrière la nuit, et de fait la voix presque enfantine du grand Kerl à boucles d’oreilles et culotte de cuir, zyeux d’azur et gabarit de lutteur, s’envolait le long des flèches de la Chagallkirche en arrachant à chacun d’irrépressibles frissons, et Milena se sentait fondre au côté d’un Jim de plus en plus absent, murmurant vaguement un OM continu, Milena retrouvait dans la voix du berger des accents de ses montagnes natales dont ses oncles lui chantaient parfois les complaintes, et déjà, aux accents excessivement sentimentaux de ses jodels, les filles de bar avaient compris ce qui se passait entre ces deux-là, tout en sachant que le Hans leur reviendrait avec son rire clair et ses vrenelis, et c’était justement parce qu’il y avait de l’amour dans ce chant que les filles se sentaient pures de jalousie, et la nuit paraissait s’ouvrir à toutes ces voix déployées, Jim était déjà parti vers l’Ashram mystique qui le délivrerait de toute pesanteur et les sans-logis qu’il y avait là se sentaient eux aussi dans la peau de pèlerins au bivouac stellaire, Max se réjouissait finalement d’avoir raté le dernier tram de Zumikon et d’être tombé dans cette bande de chiens sans colliers: même si cela ne faisait pas un pli que le monde continuerait de mal tourner en dépit des essais de révolutions du printemps dernier, même si la sauvagerie se perpétuait, son idéal restait chevillé au corps du vieux disciple du Mahatma et les chants de cette nuit le faisaient se sentir un peu meilleur, comme il en allait de Tonio - serveur à la Bodega et grand lecteur de Pavese - et de tous les traîne-patins que la première rumeur avait attiré des ruelles du Niederdorf au bord de l’eau fraîche à la forte odeur de poisson vif, et ils étaient bien une trentaine vers minuit, mais maintenant la nuit avait basculé sur son axe et le chant commençait de s’espacer, des couples s’en allaient vers les bosquets du Lido, d’autres parlaient à voix basse ou prenaient congé, on se souhaitait bel été ou bonne vie, Jim avait laissé Milena se réfugier dans les bras du contre-alto Sonnenberg cependant que Tonio et Verena faisaient un feu sur la berge de la rivière, et leurs visages éclairés paraissaient plus beaux encore de surgir ainsi de l’obscurité, Jim resterait encore longtemps sur l’empieremment de la berge, les paumes ouvertes et les yeux clos, à se remplir d’énergie cosmique, Hans et Milena continueraient de murmurer à ses côtés, les filles de bar regagneraient leurs studios et des pluies d’étoiles tomberaient encore au fond du ciel que les échos de toutes les voix de ce soir-là retentiraient toujours dans la nuit...

Le premier mot,
le premier nom,
le premier objet
furent les premiers élus de l’enfant-dieu
salivant à fleur d’océan,
au sommeil vrillé d’effrois,
aux éveils cinglés de lumière
et cernés de voix.
Avant le langage : cette guerre.
Et l’armistice ensuite de tous les mots émissaires.
Pendant le langage sera donc une fête.
Pour l’enfance : une collection.
En adolescence : ces passions même sans noms.
Et tous les mots enfin
autour du langage.
Cage toute
aux oiseaux d’erre.
(Cap d’Agde, 29 mai)