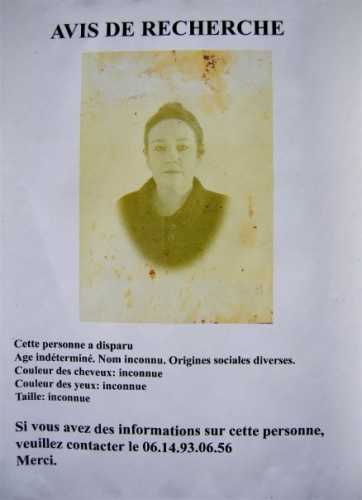Méfiez-vous des enfants sages, type représentatif du premier roman prometteur, marque l’apparition d’un nouveau talent de vingt ans : Cécile Coulon. À laquelle on souhaite la longévité de Sagan…
Cécile Coulon, née en 1990 et grandie sous les volcans d’Auvergne, déboule en souplesse, et le sourire lavé au Coca, dans la cour de la rentrée littéraire, avec son premier roman intitulé Méfiez-vous des enfants sages et publié par une éditrice, Viviane Hamy, au catalogue littéraire de bon renom .
La concurrence sera rude, puisque 85 premiers romans se trouvaient au départ. Déjà, quelques nouveaux auteurs, pas forcément jeunots, ont été repérés. Telle Douma Loup, romancière genevoise de 27 ans qui s’affirme d’emblée, avec L’embrasure, paru au Mercure de France, par une écriture très originale, plus mûre assurément que celle de Cécile Coulon.
Mais la fringante Cécile a de bons atouts pour elle. D’abord parce qu’elle a, de toute évidence, la « papatte », qui distingue un écrivain d’un faiseur. Elle a le sens du mot, le sens du récit, le sens de la construction, le sens des personnages. Ensuite, elle ressaisit, avec un mélange de candeur et de culot, les thèmes et le ton, les carences affectives et la révolte individualiste de la jeunesse du tournant du siècle, comme Françoise Sagan exprimait le ton et les thèmes de sa génération en veine de libération, au mitan des années 1950. Cécile est-elle pour autant la nouvelle Sagan ? Probablement pas plus qu’elle n’est la nouvelle Carson McCullers évoquée par l’éditeur.
Mais le fait est que Cécile Coulon, comme l’an dernier le très jeune Sacha Sperling, auteur de Mes illusions donnent sur la cour, et comparé lui aussi à Sagan pour sa précocité, correspond aux normes, voire aux fantasmes liés au jeune auteur béni des fées rappelant évidemment le Raymond Radiguet du Diable au corps. Pour mémoire, rappelons que Bernard Grasset lança ce premier roman, en 1923, année de la mort du jeune prodige, « comme un savon » en annonçant « le premier livre d’un romancier de 17 ans », quitte à susciter la réprobation de pas mal de critiques peu accoutumés à ces mœurs publicitaires…
Un peu moins d’un siècle plus tard, le bluff et les « coups » éditoriaux ou médiatiques aidant, le risque advient, pour un jeune auteur, d’être lancé de la même façon, quitte à être abandonné dans la foulée s’il ne « marche » pas. À cet égard, nous pourrions aligner une liste de nouveaux Radiguet et de nouvelles Sagan qui ont fait « pschiitt » avant d’être relégués dans les oubliettes. Or, ces jeunes auteurs de premiers romans font encore figure de privilégiées par rapport à tous ceux dont les débuts non remarqués resteront sans lendemain.
Cécile Coulon, bien dans sa peau et bien entourée, poursuit ses études à Clermont-Ferrand en affirmant qu’elle aimerait bien élever des chèvres, acheter des motos et se couper les cheveux, sans savoir dans quel ordre le faire. « Donc, en attendant, j’écris un nouveau roman ». Le premier a l’air américain, du côté de marginaux à la Carver. Pourtant elle se défend d’avoir écrit un roman américain avec Méfiez-vous des enfants sages. « C’est un roman qui se déroule aux Etats-Unis, ce qui est très différent. J’ai choisi ce lieu car d’une part, c’est le lieu de tous les possibles, et d’autre part, parce qu’à ce moment là, j’étais réellement accro à la culture américaine littéraire, cinématographique, musicale et populaire, et je le suis toujours. Disons que le logo Coca-Cola m’inspire beaucoup plus qu’une conserve de petits pois Bonduelle »…
Doux oiseau de jeunesse
On pense un peu (notamment) aux nouvelles douces-acides de Raymond Carver en lisant Méfiez-vous des enfants sages, autant à cause de ses personnages non conventionnels, voire un peu paumés, que pour le climat de bohème romantique qui le baigne. C’est d’abord le pur bonheur d’être au monde, éprouvé par Kerrie depuis qu’elle a débarqué à San Francisco de son trou de province, à vingt ans et des poussières.
Puis, dans la petite ville du sud où elle est revenue après la mort de sa mère, c’est la vie partagée avec Markku le Suédois, passionné d’entomologie et s’éloignant peu à peu, et avec leur fille Lua, très indépendante en dépit de la tendresse qu’elle porte aux siens, et développant une amitié farouche pour Eddy l’ex-junkie. À la mort solitaire de son «vieux pote», Lua connaîtra son premier grand chagrin, entre autres expériences formatrices.
Au fil d’une narration jouant sur des points de vue alternés, ce premier roman d’apprentissage filtre bien les désarrois et la révolte de l’ado révoltée, avec un regard lucide sur son époque et sa propre génération. Or, l’étonnante maturité de la romancière le dispute à une pétillante fraîcheur, qui fait passer quelques faiblesses et autres facilités juvéniles.
Cécile Coulon, Méfiez-vous des enfants sages.Editions Viviane Hamy, 107p
Ces articles ont paru dans l'édition de 24Heures de ce samedi 18 septembre.
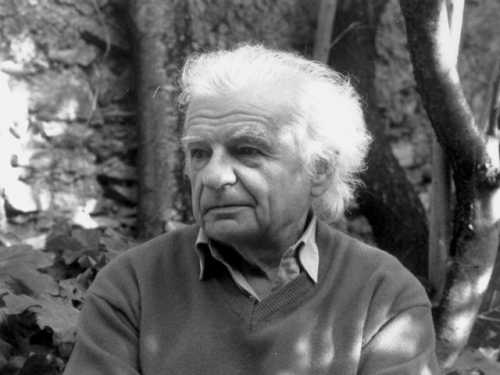
 - Que diriez-vous aujourd’hui à un jeune poète ?
- Que diriez-vous aujourd’hui à un jeune poète ?
 Doux oiseau de jeunesse
Doux oiseau de jeunesse