
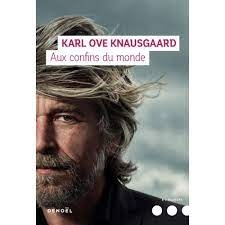

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

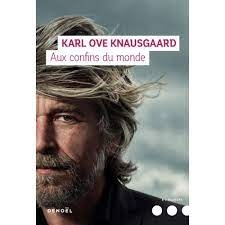

L’enfant Number Two à sa sœur aînée qui accepte enfin de lui prêter son petit vélo : « Et c’est pour la vie ? »
°°°
Il y a de l’incendiaire chez Thomas Bernhard, autant que du gardien du feu. Cependant, à brandir le feu sacré partout où il va, je crains parfois que la lumière de celui-là ne se perde. Or, il n’en est pas moins à écouter, qui nous parle de la Suisse en nous parlant de l’Autriche, d’un philistin l’autre, de la torpeur et de la vulgarité, du refus croissant de penser, de la stupidité vorace du parvenu, de l’indifférence rampante, de l’insensibilité satisfaite ou de la bonne conscience verrouillée.
°°°
Au lieu de conspuer la médiocrité ambiante, s’attacher silencieusement, à l’écart des estrades, à en limiter les effets et les méfaits par son seul travail. Se dire à tout moment que rien ne sera perdu tant qu’on restera fidèle à cette obscure et non moins rigoureuse discipline. Là est le vrai travail et la vraie satisfaction : dans l’effacement et le fruit. Là est la vraie défense de la Qualité.
°°°
Hofmannstahl :« La peinture change l’espace en temps ; la musique le temps en espace ».
À quoi j’ajoute avec un grain de sel : « Et la littérature arpente le temps de la musique dans l’espace de la peinture ».
°°°
Proudhon :« Les journaux sont les cimetières des idées. »
À quoi j’ajoute avec un grain de sel : « Et parfois, tel Lazare, une idée s’en relève. »
°°°
Ce mot de l’enfant Number Two : « Et le nom de famille de Dieu, c’est quoi ? »
°°°
Ils tirent leur petite journée en l’entrecoupant de petits cafés. Le soir ils se font une petite vidéo en éclusant un petit verre. À la fin de la semaine ils s’accordent un petit câlin et, de temps à autre, se font une petite fête entre amis. Ce qu’ils appellent vivre dangereusement.
°°°
Trait d’époque : un prof demande à l’un de ses étudiants s’il a lu Les liaisons dangereuses. Et de s’entendre répondre : « Pas personnellement. »
°°°
« Qui écrit ne voit plus et qui voit n’écrit plus », note Jean-Claude Renard. Avec raison : il faut écrire les yeux fermés.
°°°
Il y a un mécanisme de la destruction, tandis que la création ne peut être qu’organique.
°°°
Ceci de Jacques Chardonne que je contresigne ce matin clair: «L’accent de la prose, c’est l’intime philosophie de l’homme, son secret. Pour lui-même,secret. »
Et cela surtout : « Dans le style le plus simple que la phrase soit vierge. On veut une neige fraîche où personne encore n’a marché ».
°°°
Rendre grâces : cela seul devrait suffire à nous justifier. Glorifier le monde donné. Au lieu de se borner à prendre et jouir : magnifier et transmettre.
°°°
Tout nous fait signe. Tout nous appelle à être reconnu. Tout a besoin de nous.
°°°
Attention au langage. Notre bien commun. Ne pas saccager.
°°°
Cap d’Agde, en mars 1992. – Ce mot de Number Two sur la plage naturiste : « Toutes ces saucisses ! »
°°°
Le sexe devenu l’axe du vide : ce puits sans fond.
°°°
Drôles de gens d’un drôle de monde : toute la journée sur la plage ou devant leur télé, sans un livre. Matière, matière, matière, et encore : tellement inconsistante.
Mais voici que l’espoir renaît avec un début de conversation. Vannes de banlieusards. Drague douce. Grâce des gosses à leurs jeux. Anchois frais à l’apéro !
°°°
Rien à dire d’Alexandre Jardin, sinon : ce bon jeune homme.
°°°
Claudel en 1925 : « C’est une hygiène déplorable que de se regarder. On se fausse en se regardant : on fabrique une espèce d’individu artificiel qui remplace la personne naïve et agissante. Le véritable soi-même est révélé par les circonstances et c’est pourquoi le drame a une vérité bien supérieure à celle du roman, parce qu’il met l’action à la première place, les personnages n’étant que les fonctions de cette action qu’il suscite. »
Ce que je traduis en ordre de marche personnel : fuir les miroirs et courir aux fenêtres.
°°°
Et si ce qu’on appelle Dieu était à la fois le Bien et le Mal, qu’il incomberait à l’homme de démêler ?
