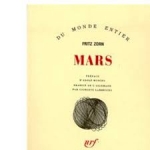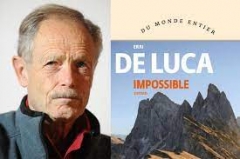Par Albert Caraco
C’est un grand écrivain et qui n’aura peut-être jamais beaucoup de lecteurs, parce qu’il est profond en restant monotone et, quand il est sublime, en demeurant étroit. J’ai de l’estime pour sa façon de penser, j’en ai de plus en plus pour sa façon d’écrire, mais je ne parviens pas à l’aimer : les puritains me refroidissent et c’est un puritain des lettres, on me dira que nous en manquons effroyablement et que les imposteurs mènent le bal, on me dira que Ludwig Hohl est le Cézanne de ces temps, et que son œuvre réfléchit la probité la plus entière… Mais quoi ? Je lui pardonnerais d’avoir moins de rigueur, s’ils montrait parfois plus de charmes et de grâces; il m’en impose, je l’avoue, et cependant il me repousse, il a souvent raison, il n’en devient pas toujours plus aimable. Est-ce l’effet de la raison ou de l’intransigeance de l’auteur ? Les deux sans doute.
À qui ressemble-t-il ? À Lichtenberg ? En apparence seulement, parce que Lichtenberg est drôle et que notre auteur, lui, ne l’est presque jamais. À Wittgenstein ? Non pas, car Wittgenstein est un savant et qui paraît avoir l’esprit mathématique, où Ludwig Hohl moralise à peu près comme nous respirons, quand il ne prêche. À Jean-Paul ? Jean-Paul est souvent illisible est toujours trop sentimental avec, de plus, le goût des digressions ou des parenthèses, quand Ludwig Hohl se lit facilement encore qu’il ne soit pas tellement plaisant à lire. Il est original, à n’en pouvoir douter, il ne l’ignore point et même il va jusqu’à nous le remémorer. Il parle, au reste, incessamment de sa personne, ce puritain ne s’oublie guère, il n’a rien d’un ascète, c’est un peu ce qu’on appelait un juste. Voilà, me semble-t-il, le mot est lâché : Ludwig Hohl est un juste. Il est incomparable dans ses méditations touchant la pauvreté, ni Proudhon ni Marx ne sont allés plus loin, c’est un sujet qu’on n'aime pas a définir, cela me remet en mémoire certaines pages de Péguy, voire de Léon Bloy, à cette différence près que Ludwig Hohl est un athée, ayant quelques parties de philosophe. Son athéisme et radical et l’on a l’impression qu’il ne reviendra plus sur cette attitude. Er ist ein gottloser Mensch, aber kein geistloser, das Gegenstück von Léon Bloy, ein Denker ohne Glauben, verzweifelt und dennoch verklärt, mit Weisheit ausgerüstet und dennoch abstossend. Er ist ein ausgemachter deutscher, nach innen offen manchmal sogar nach oben. Er spintisiert ein wenig wie der Schumacher aus Görlitz, ein wenig langweilig, ein bischen dumpf, und plötzlich blitzt er und der geist erscheint.
Traduire Ludwig Hohl me paraît difficile, le français ne se prête guère aux ruminations mentales et l’espagnol encore moins. Man fühlt das Werden der Gedanken und ihr Wachsen, bei den Frazosen un den Spanien spürt man bloss die Endform. La pensée de l’auteur est à l’état naissant. Avec cela, c’est un esprit solide, il marche volontiers à pas de plomb, en ahanant un peu. J’admire son bon sens, c’est un cyclope, die Arbeit ist sein Leitmotiv, il parle topujours de travail avec une insistance pathétique. Der Lob des schweren materials klingt durchaus calibanisch : c’est donc un Caliban de bonne volonté, qui rêve d’être un Ariel. Ludwig Hohl hat eben keine Schwingen, er besteigt immerhin die höchsten Berge, doch vierfüssig, mit Zähnen une mit Nägeln.
Je reconnais qu’il touche parfois au sublime encore qu’il ne reste pas assez dans ses hauteurs, il n’a point trouvé l’art de s’y faire une place, il est gradualiste, il n’est pas subitiste et nous dirons que c’est un juste auquel la grâce aura manqué.
Cet homme surprenant attendait le miracle, il attendait, outre la gloire, un ou plusieurs mécènes, il n’a pas trouvé l’être providentiel qu’il espérait, de là ses pages les plus déchirantes, – non sans complaisance (mais nous la lui pardonnerons ) il professera son génie (Porträt ). Hohl a certes des éclairs de génie et voilà qui nous remémore un Lichtenberg ; Il manque à l’un tout comme à l’autre un certain don de la synthèse, à quoi les auteurs des génies se peuvent reconnaître. Er zieht di Bruch stücke dem Zusammenhange vor, weil es ihm nicht gelingen ist, bis zur Synthese zu gelangen. Doch dies beweist nicht nur, dass er ein Schöpfer sei. Je lui reproche je n’avoir pas lu les philosophes et s’il résonne sur la praxis é la façon d’un Engels, ke me méfie un peu de son socialisme, où je découvre des relents de stalinisme.
Comment ne goûterait-on pas ses pages sur le métier d’écrivain ? C’est là qu’ils montre souvent le meilleur de son esprit et quand je le lis je crois voir Cézanne, ses maladresses et sa probité, touchantes et parfois sublimes. Il tourne souvent dans le cercle mais il y fait – de temps en temps– entrer le monde, aussi beaucoup lui sera pardonné, même sa manie de tout rapporter à Ludwig Hohl, lequel est le Dieu de ses livres, et dont la présence est réelle, fût-elle bien caché.
Avec cela, c’est un historien et - s’il le voulait– des plus remarquables, dommage qu’il n’en traite pas assez souvent et que l’histoire en somme l’intéresse moins que Ludwig Hohl. Son essai touchant la Réforme (2) ne peut que susciter mon admiration, ses réflexions sur l’Eglise sont pareillement heureuses. L’on souhaiterait qu’il donnât plusieurs morceaux de cette qualité. Hohl est un conteur symboliste, a l’instar d’un Kafka, il marie les sous-entendus et l’évidence d’une manière qu’il est permis d’appeler de l’art. Son Vernunft und Güte est un chef-d’œuvre et c’est le canevas d’un grand roman, genre Noeud de vipères de Mauriac. Est-ce le reflet de sa propre vie ? Au fond, son drame est d’être Suisse. En un pays comme la Suisse, où l’on manque à ce point de malheureux qu’il faut les importer pour leur commettre ces travaux auxquels les habitants préféreront l’exil, Hohl est un phénomène et je présume que d’aucuns le lui reprochent.; il n’est pas devenu célèbre, alors que d’autres, moins doués le sont, puis il est resté pauvre en une contrée où l’on a la religion de l’ordre, de l’efficace, du rendement et des vertus civiques. Il est un peu hors cadre. Est-ce sa faute ? En quels pays serait-il vraiment à sa juste place ? Comment répondre ? Une existence, que l’esprit informe, sera toujours un cas d’espèce et sa reconnaissance, de la part des hommes, un miracle. Lui reprocherons-nous de l’avoir attendu ?
Albert Caraco
(1) Nuances et détails III/9
(2) Notes.
Ce texte a paru dans la livraison de La Revue de Belles-Lettres, No3, 1969, consacrée à Ludwig Hohl.