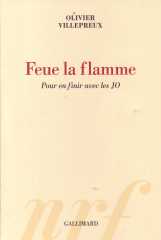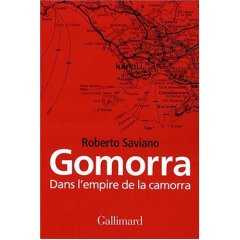
Une plongée saisissante dans les guerres à l’italienne
« Je suis né en terre de camorra, l’endroit d’Europe qui compte le plus de morts par assassinat, là où la violence est le plus liée aux affaires et où rien n’a de valeur s’il ne génère pas le pouvoir », écrit le jeune (né en 1979) journaliste d’investigation Roberto Saviano, dont l’ouvrage a fait l’objet d’un film à découvrir bientôt, et qui vit actuellement sous protection policière. Le contenu de Gomorra est en effet aussi explosif qu’instructif, qui nous révèle l’incroyable emprise, sur toute une société, des clans du crime organisé, à Naples et en Campanie, mais également bien au-delà. A la différence d’une enquête journalistique classique, ce récit témoigne d’une immersion biographique dans le milieu décrit avec une familiarité et une vivacité qui vont de pair avec le besoin du jeune observateur d’exorciser un mal à la fois local et mondial (maints points communs y apparaissant entre le Clan mafieux et l’Entreprise néolibérale), question de survie, « la seule chose qui permet de sentir qu’on est encore un homme digne de respirer ». Du fonctionnement du Système aux guerres implacables entre clans, des ateliers de contrefaçons de marques au commerce des armes et de la drogue, de l’exploitation des enfants (baby-dealers) à celle des femmes, en passant par les métastases du cancer à l’Est, l’aperçu, très incarné, brassant la langue, est saisissant.
Roberto Saviano. Gomorra ; dans l’empire de la camorra. Traduit de l’italien par Vincent Raynaud. Gallimard, 356p.
-
-
Jeux olympiques de dupes
COUAC Un amateur de sport prône l’abolition pure et simple
Olivier Villepreux n’y va pas par quatre chemin à la veille des Jeux de Pékin, relançant selon lui une parodie hypocrite de célébration, par la jeunesse du monde, de « l’amitié entre les peuples ». L’auteur de Feue la flamme n’est pas précisément un ronchon mal dans sa peau : fils d’un célèbre international de rugby, lui-même journaliste sportif à Libération, auteur d’un Larousse du rugby, on sent l’amoureux déçu dans le pamphlétaire de Feue la flamme, dont les 109 pages virulentes s’achèvent sur ces propos carabinés : « Les Jeux participent à la négation de la nature et au mépèris de l’espèce humaine »…
Si l’ouverture est franco-française, avec le rappel du débat pour l’élection présidentielle de 2007, entre un Nicolas Sarkozy « favorable aux Jeux » et une Ségolène Royal se tortillant un peu réclamant « des pressions sur la Chine » sans boycott pour autant, le botteur verbal en vient vite au fait que « la Chine est un pays liberticide, en pleine croissance, courtisée pour sa main-d’œuvre asservie et ses débouchés économiques », et que «les jeux Olympiques consacrent sa prise de pouvoir sur l’économie mondiale ». Or Olivier Villepreux ne s’en prend pas qu’aux éditions les plus controversées des J.O. de Berlin à Moscou : c’est l’institution dès ses débuts, frappée d’équivoque et d’hypocrisie, qu’il remet en cause avant d’en appeler à leur suppression.
Olivier Villepreux. Feue la flamme ; pour en finir avec les J.O. Gallimard, 109p.
-
Le mur dans les têtes

IMPASSE Un « nouvel historien » israélien critique les faucons.
Si son esprit de guerrier n’était pas actuellement en veilleuse, Ariel Sharon rugirait à la lecture des pages qui lui sont consacrées dans cette vaste fresque reconstituant, dès la naissance d’Israël, le 14 mai 1948, après un rappel des fondements du sionisme, et jusqu’à l’épilogue tout à fait contemporain, six décennies de relations entre Israël et le monde arabe. Sharon, qui récusa lui-même les « nouveaux historiens » dont fait partie Avi Shlaim (né en 1945 à Bagdad), est en effet présenté comme l’un des fauteurs principaux de l’ «unilatéralisme», ennemi juré de la paix qui, entre autres mesures violentes, engagea la construction de la « barrière de sécurité » aux allures de mur d’apartheid. Or l’idée dudit mur à toute une histoire, remontant initialement à un article datant de 1923 et signé par Zeev Jabotinsky (1880-1940), nationaliste juif et père spirituel de la droite israélienne, qui estimait la coexistence des Arabes et des Juifs de Palestine possible, à long terme, mais seulement « après l’édification d’une muraille imprenable ». Or il s’agissait d’une mesure de protection provisoire liée à une reconnaissance implicite de l’entité nationale palestinienne. Le mur, métaphore et réalité, court ainsi à travers cet ouvrage extrêmement bien documenté, cartes et références à l’appui, où le dilemme d’Israël (« il peut avoir la terre ou la paix. Pas les deux»…) ne sera résolu, selon l’auteur, que par la coexistence de deux Etats.
Avi Shalam. Le mur de fer ; Israël et le monde arabe. Traduit de l’anglais par Odile Demange. Buchet-Chastel, 757p.