A La Désirade, ce dimanche 14 janvier. – Cette évocation hivernale de la baie de Montreux vue des hauts, par Varlin, rend bien la tonalité de ce dimanche d’hiver et fait écho, à l’instant, à ces mots que je lis dans le dernier livre de Catherine Safonoff, intitulé Autour de ma mère et me rappelant à tout moment les notes sensibles du livre que je préfère de Peter Handke, Le poids du monde : « Je me rappelle l’hiver dernier, un hiver gris et froid tendu par une sorte de courage mécanique. On écrivait tous les jours, à 16 heures on rangeait les papiers et on partait marcher. J’allais d’un bon pas dans le froid, toujours le même parcours, la nuit tombait, de retour je montais le chauffage, faisais du thé, un peu de ménage, des exercices de grec, écoutais la radio – oui, un bon hiver régulier et les longs soirs étaient assez heureux, tout autour de la maison c’était un beau froid noir et muet ».
Voilà, c’est exactement ça que nous avons ce dimanche matin, ce « beau froid noir et muet », et le murmure de Safonoff me touche et me fait lever les yeux à tout moment, comme hier soir et tous ces soirs le Journal de Kafka, qu’elle dit elle aussi lire en continu, me rappelant également ce seul titre de Handke que ces pages illustrent précisément : L’heure de la sensation vraie
« Une seule chose a compté dans ma vie, écrit Safonoff, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un ». C’est exactement ce que dit aussi Sarah Kane dans le dernier roman d’Arnaud Cathrine, et c’est ce que j’ai écrit dans mes carnets de l’année dernière, et cela aussi du murmure de Safonoff trouve un immédiat écho en moi : « Je n’aime pas ne pas revenir à quelqu’un ». C’est pourquoi j’en ai tant bavé, moi, de ne pas voir certains de mes amis ne jamais revenir. Moi je serais toujours revenu mais le sentiment qu’ils ne reviendraient jamais ni sur ce qu’ils ont dit ni sur ce qu’ils ont fait, parce que leur hubris, leur orgueil, leur paresse, la face à ne pas perdre les en empêchait, cette évidence qu’ils ne reviendraient pas sauf à revenir où ils étaient restés, autant dire une petite mort, m’ont paralysé. Ici, chez Safonoff, on est dans la fragilité pure de qui aime et qui aimerait aimé.
Voici ce qu’elle écrit d’un enfant, elle la vieille petite fille. « Après-midi avec Rémy, quinze mois. Il a un grand attachement pour Doudou, un hippopotame mou recouvert de tissu éponge verdâtre. La peluche est devenue morveuse, croûteuse, malodorante. Parfois l’enfant me la tend mais sans la lâcher. Sucé, cajolé, trituré, Doudou est la chair d’une chair originelle. Je me demande quand Rémy quittera son Doudou et par quoi il le remplacera. Il s’endort, tétant la queue de son hippopotame. Je me demande quels sont mes objets transitionnels et vers quoi ils me transitionnent ».
Mon objet transitionnel de ce dimanche froid noir et muet est ce livre qui filtre la vie avec une justesse de chaque mot et de chaque silence. C’est un livre proustien à l’état de notes apparemment éparses, mais tenues ensemble par-dessous ou dedans, qui pourrait avoir 100 ou 1000 pages. C’est un livre qui ne se discute pas. Je dois aller en parler mercredi prochain à la radio et voilà ce que je dirai : on ne discute pas ce livre, ce livre est ce qu’il est, c’est un objet transitionnel qui a la couleur de la tristesse et d’une joie discrète…

-
-
Strindberg déconstruit
En création française à Vidy, une nouvelle version du Pélican laisse froid
On devrait cramer vif à l’issue de cette terrifiante, infernale petite pièce des dernières années de Strindberg, conçue (en 1907) pour le fameux Théâtre Intime du génial dramaturge et concentrant une puissance de haine et de vengeance qui confine au délire, mais il n’y a que les mots qui brûlent dans la maison qu’ils annoncent en feu, au terme de cette représentation du Pélican mise en scène par Gian Manuel Rau au théâtre de Vidy, dans une nouvelle traduction de René Zahnd.
A l’image de la scénographie d’Anne Hölck, figurant un intérieur hideux à l’agencement et aux meubles chaotiques, où telle méridienne mitée jouxte un escalier pseudo-moderne se contordant le long des murs, c’est dans un affreux cercle familial que nous fait pénétrer Le Pélican, dont les personnages qui s’y affrontent évoquent aussitôt une cage aux fauves ou un cabanon de déments graves.
Après l’enterrement du père, qu’a suivi le mariage du gendre (honni par le vieux) et de la fille à dégaine de femme-enfant, la mère revient dans la maison qu’elle avait désertée pour flairer l’argent qu’elle n’a pas encore raflé, au dam du fils qui la hait, lui reprochant notamment d’avoir affamé les siens et poussé la cruauté jusqu’à voler l’argent nécessaire au bois de chauffage. On comprend bientôt, ensuite, que la mère indigne est également devenue la maîtresse de son gendre, ainsi que le fils le révèle à sa sœur, laquelle préférerait garder les yeux fermés sur la sinistre réalité qui l’entoure. Faim, froid, haine et trahison appelleront vengeance…
Il y a du cauchemar éveillé et du conte sanglant dans cet affrontement de prédateurs adultes et d’enfants pris au piège, qui évoque une antique filiation de monstres dont il semble qu’on ne puisse sortir que par une violence de plus – ainsi le fils pousse-t-il la mère à se jeter par la fenêtre avant de bouter le feu à la maison.
Passé du réalisme noir aux abrupts de l’expressionnisme, Strindberg donne peu de repères sociaux au Pélican, et pourtant on ne peut s’empêcher de penser à la société bourgeoise du début du XXe siècle en « écoutant » la mère à la fois corsetée et cynique, prétendant s’être saignée pour les siens alors quelle les a vampirisés, hypocrite et menteuse incarnée.
Dans la mise en scène de Gian Manuel Rau, tout repère historique est balayé au profit d’un chaos « déconstruit » à la Matthias Langhoff, où les personnages, exacerbés, sont réduits à des épures évoquant le théâtre hyper-violent de Bond ou de Sarah Kane. Le jeu des acteurs, merveilleusement démoniaque et mobile dans le cas de la mère à la souriante perversité (Dominique Reymond), parfaitement fondu en abjection dans celui du gendre (Roland Vouilloz) ou frémissant de sidération sensible chez la fille (Sasha Rau), perd cependant de sa force dans le rythme cassé et le décalage croissant entre mots et gestes, de reptations gratuites en effets de distanciation fleurant la resucée post-avant-gardiste. Bref, on ne croit pas trop à tout ça, malgré de beaux éclats, et l’amoureux envol final de la servante, fleurant la pièce rapportée, laisse de glace même s’il se veut chant d’amour calorifère.
Lausanne. Théâtre de Vidy. Le Pélican d’August Strindberg. Jusqu’au 28 janvier, à 19h30 sauf le dimanche (à 18h.30). Relâche dimanche 14, lundi 15 et lundi 22 janvier. Durée du spectacle : 1h.30. Location : Billeterie chez Payot-Pépinet, ou au 021 619 45 45 et sur www.vidy.chPhoto Mario del Curto: la mère (Dominique Reymond) et le fils (Bruno Subrini)
Cet article a paru dans l'édition de 24 Heures du 11 janvier 2007.
-
Pseudo et son double
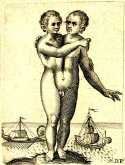
Sur La berlue de Véronique Beucler
On sourit à tout moment, et parfois même on éclate de rire à la lecture de La Berlue de Véronique Beucler, qui rappelle le meilleur Nothomb ou les romans et certaines nouvelles de Marcel Aymé, particulièrement Le romancier Martin où les personnages de celui-ci se pointent chez lui pour se plaindre du sort qu’il leur réserve. Véronique Beucler pratique une langue claire et sonnante, fruitée et charnue comme l’était celle d’Aymé, avec un rythme, un allant narratif et des trouvailles de langue et d’imagination qui ne sont qu’à elle. Très original, très amusant, réussi dans les grandes largeurs, son deuxième livre (après L’amour en page, paru en 2003) s’emberlificote un peu sur la toute fin, mais sa lecture n’en est pas moins un régal.
Je ne vais pas en dévoiler l’intrigue, sous peine de gâcher le plaisir de la découverte. Disons que ça se passe entre le merveilleux jardin d’une prof de lettres bordelaise impatiente de voir paraître son premier livre, la table d’un romancier à succès qui entrera dans sa vie après qu’un couteau lui eut été planté dans les entrailles par un ado un peu maladroit (ce sont des choses qui arrivent aujourd’hui aux dames et aux ados), les bureaux d’un éditeur très mufle et de son rival qui ne l’est pas moins, et quoi dire encore si ce n’est que les embrouilles de Romain Gary et d’Emile Ajar sont toutes simples à côté de ce qui se passe dans La Berlue, jouant sur le caractère absolument unique et personnel de ce que vous écrivez dans votre coin, que nul ne saurait concevoir et surtout pas les 666 aspirants romanciers qui se voient publiés à votre place alors que vous lanternez entre anémones du Japon, aristoloches et lettres de refus de 666 éditeurs vous baillant le même babil dilatoire. Tout cela corsé de digressions épatantes, comme celle-ci qui évoque le désarroi légitime des personnages de romans emportés dans le flot actuel: « L’époque, depuis plus de vingt ans, célébrait, en toute grégarité, le voyeurisme, le déballage, le besoin de se lâcher, de s’épancher; on se répandait. La population romanesque en faisait les frais. Violentée, abusée, souillée, décimée, hagarde, elle rendait l’âme. Les survivants avaient perdu tout souvenir des corps heureux, des corps en fêtes. (...) Le roman, hydre aux huit cents titres annuels, se réduisait à une petite affaire privée, un gratouillage de nombril ou d’entre-fesses, jeté sur la place publique »…
Véronique Beucler. La Berlue. Albin Michel, 203p.

