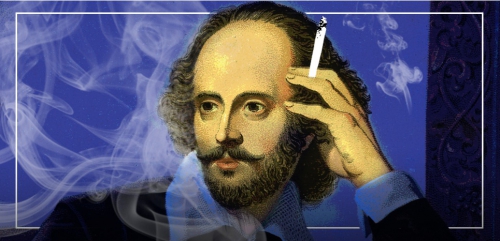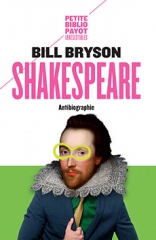À propos de l'auberge espagnole shakespearienne et des multiples entrées du Globe. L'éclatant fronton de Denis Podalydès et la dégaine de tartare du Macbeth d'Orson Welles. La chape des puritains et le recyclage du politiquement correct.
Lire Shakespeare, à tous les sens du terme, autrement dit en déchiffrer les 37 pièces et les monter aussitôt imaginairement ou en 3D si l'on est Peter Brook, relève d'une expérience vitale qui échappe à toutes les écoles et tous les snobismes, à toute revendication nationale ou toute récupération politique ou idéologique, étant entendu (dixit Peter Brook lui-même) que le Barde déploie "une réalité faisant concurrence à notre réalité ", non pas en proposant un point de vue sur le monde mais en nous ouvrant un monde en lequel on voit mieux jusqu'à la plus impénétrable obscurité du monde, évoquée par une poésie à multiples voix.

Un acteur français peut-il comprendre cela ? Certes il le peut aussi bien qu'un savetier japonais ou qu'un pêcheur norvégien ou qu'une pharmacienne sarde: la preuve rutilante en est donnée par l'inapprecuable commentaire du comédien-auteur-lecteur Denis Podalydes, dont l'introduction au mirifique Album de la Pléiade paru en mars 2016, donc pile 400 ans et quelques minutes après la mort probablement certaine de Shakespeare, est à citer texto: "La lecture des pièces de Shakespeare est un voyage odysséen que seules permettent les très grandes œuvres. On y fait l'expérience de l'Histoire, du temps et de la diversité humaine, dans le sentiment exaltant de reconnaître l'un ou l'autre d'entre nous, soi-même enfin, d'exister et de se mouvoir dans une réalité objective dotée de toutes les contradictions, tant la vie de ces personnages, rois, princes, clowns, paysans, soldats, bourgeois, esprits, créatures mythologiques, hommes et femmes formant la plus hétéroclite des populations, nous point, nous déborde, nous bouleverse, nous emporte. Au détour d'une scène ou d'une réplique, à la Cour, sur un champ de bataille, dans une taverne, au Danemark, en Ecosse ou à Venise, dans la forêt d'Ardenne ou dans une île imaginaire, nous sommes saisis par un détail, une image, un trait qui ont à la fois la saveur immédiate du réel et là subtilité immatérielle de la poésie ".
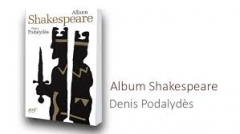
C'est entendu: tout le monde aujourd'hui à une opinion et se croit obligé de la produire illico sur Twitter. Mais une opinion n'engage à rien sans examen patient et précis de l'objet. Parler de Shakespeare ou de Proust fait peut être chic dans les salons ou les réseaux sociaux qui en sont un nouvel avatar plus chaotique, mais cela n'a pas plus de sens que de n'en rien savoir et le dire tranquillement vu qu'on a déjà sa vie à vivre. Or Shakespeare est précisément la vie qu'on est en train de vivre ou plus exactement le miroir à la fois externe et intérieur que nous traînons depuis toujours le long de notre bonhomme de temps, de notre enfance ultrasensible et jusqu'à notre mort tout à l'heure.
Tolstoi à proféré l'opinion la plus stupide, même pas digne d'un perroquet numérique, en affirmant qu'il donnerait tout Shakespeare pour une paire de bottes nécessaire à un moujik va- nu-pieds. C'est dire que le cher comte ignorait que les gueux qui assistaient à Londres aux spectacles gratuits des scènes ouvertes construites à côté des bordels et parfois avec passages communicants, comprenaient Shakespeare sans avoir appris le russe.

Ainsi que le rappelle encore Denis Podalydès dans cet indispensable Album, l'histoire des théâtres construits dans les quartiers populaires, au temps de Shakespeare & ci, est indissolublement liée à une production d'époque florissante, en concurrence-opposition directe avec l'Université et l'Eglise, et s'explique autant alors le pseudo mystère de l'immense savoir humain et juridique, moral ou politique, littéraire ou théâtral (au sens de l'artisanat) de Shakespeare, et son succès phénoménal d'auteur bientôt capable d'offrir à ses enfants des play stations dernier cri.
Dans la version d'Orson Welles, Macbeth à la dégaine d'un cavalier tartare et le film semble russe à outrance, mais l'essentiel est là, contrairement à ce qu'ont prétendu les philistins américains ou français à la sortie de ce film "maudit" , et l'essentiel n'est pas moins totalement ressaisi par Akira Kurosawa dans Le château de l'araignée.

La réception de Shakespeare selon les époques en dit plus long sur celles-ci que sur celui-là. Je ne dirai pas que je donnerai tout le puritanisme anglais pour une pièce de Shakespeare, pas plus que celui-ci n'est anticlérical au sens des nouveaux réducteurs de têtes, mais le fait est qu'une terrible chape a pesé sur cette œuvre à mes yeux vitale et même "sainte" en sa profonde bonté, comme le calvinisme en nos régions, avec l'appui massif du Pasteur et du Pion, a congelé les imaginations et surveillé les conduites publiques et privées jusqu'à brûler des corps et traiter des âmes à l'électrochoc. Shakespeare, pas plus que Rabelais d'ailleurs, n'est pourtant obscène ni subversif sauf à s'opposer moralement et politiquement à l'obscénité et au terrorisme étatique des hypocrites et des imposteurs.

Il m'a fallu à peu près un demi-siècle, durant lequel j’aurai vu des quantités de versions de nombreuses pièces du Barde, pour découvrir la simplicité profonde d'une œuvre ressaisissant la complexité humaine dans un langage que ses multiples registres font parler à tous au gré de ses degrés, et sa communicative vitalité. Oui, comme le dit Denis Podalydès, “la lecture des pièces de Shakespeare est un voyage odysséen” et demain je passerai des tragédies aux comédies, à la rencontre à Venise de Shylock, tout en ne cessant de multiplier les regards latéraux sur le théâtre du monde...